 Découvert par Jacques Cartier en 1534, le Québec (Province de l'actuel Canada) est la première colonie française en Amérique du nord, après la fondation de la ville de Québec par Champlain en 1608. Son histoire se confond donc à ses débuts avec celle de la Nouvelle-France. Pour comprendre la psychologie québécoise, il convient de se référer sans cesse à ce prestigieux passé qui vit les explorateur français donner au royaume un empire colonial immense qui couvrait la majeure partie du Canada et une grande partie des Etats-Unis. Mais ni les Français, ni les Anglais ne furent les premiers habitants du Québec et une histoire de ce territoire, grand comme trois fois la France, ne saurait ignorer ce qui s'est passé avant l'arrivée du premier Européen.
Découvert par Jacques Cartier en 1534, le Québec (Province de l'actuel Canada) est la première colonie française en Amérique du nord, après la fondation de la ville de Québec par Champlain en 1608. Son histoire se confond donc à ses débuts avec celle de la Nouvelle-France. Pour comprendre la psychologie québécoise, il convient de se référer sans cesse à ce prestigieux passé qui vit les explorateur français donner au royaume un empire colonial immense qui couvrait la majeure partie du Canada et une grande partie des Etats-Unis. Mais ni les Français, ni les Anglais ne furent les premiers habitants du Québec et une histoire de ce territoire, grand comme trois fois la France, ne saurait ignorer ce qui s'est passé avant l'arrivée du premier Européen.
L'histoire du Québec indien
On admet généralement que le peuplement de l'Amérique du nord s'est essentiellement effectué par le détroit de Béring, voici plus de 20000 ans, à l'époque glaciaire. Des vestiges archéologiques témoignent de la présence d'un habitat de chasseurs paléolithiques dans la vallée du Saint-Laurent voici 10000 ans. Plusieurs milliers d'années plus tard, la chasse, la pêche et la cueillette cédèrent la place à des embryons d'agriculture. L'outillage se diversifia. La pierre taillée puis polie, fut remplacée progressivement par le cuivre. La présence de minéraux provenant de Pennsylvanie et du Labrador montre l'existence d'un réseau d'échanges important. Le peuplement s'étendit vers les Laurentides et la poterie fit son apparition voici environ 5000 ans.
L'arrivée des Inuits, qui remplacèrent les Tunits, aujourd'hui disparus, fut plus tardive ; ils ne seraient parvenus sur le territoire du Québec qu'un millier d'années avant notre ère. Sur deux pierres trouvées dans les Cantons de l'Est, on a cru découvrir une écriture phénicienne. On pense que des moines irlandais, chassés par les Vikings, auraient pu se réfugier dans le Golfe du Saint-Laurent vers la fin du 9ème siècle. Vers l'an 1000, dans le sillage d'Erik le Rouge, installé en Islande, qui explora Terre-Neuve, des Vikings s'installèrent sur la côte canadienne laissant des traces de leur présence jusque vers 1340. Lors de l'arrivée des Européens, les tribus indiennes cultivaient déjà le maïs, la courge, le tournesol et le haricot, même si ce début d'agriculture n'était pas très ancien. La population indienne s'élevait alors à quelques 30000 individus sur le territoire du Québec actuel.
 Au début du 16ème siècle, au cours de campagnes de pêche à la morue, des navigateurs français, notamment basques, fréquentèrent les environs de Terre-Neuve. Ils ramenèrent en France quelques Amérindiens. En 1520, une colonie portugaise éphémère s’établit au Cap-Breton. En 1524, des marchands et le roi de France, François Ier, commanditèrent un explorateur florentin, Jean de Verrazane (ou Verrazzano - 1485-1528), pour trouver un passage par l'ouest vers l'Orient mystérieux. La France, qui s’était laissée distancer par d'autres pays européens dans la course aux découvertes, entendait combler son retard. L'expédition échoua, Verrazzano revint bredouille, après avoir exploré la côte américaine de la Floride à Terre-Neuve. Mais le mouvement était lancé et, sur les cartes de l'époque, apparurent bientôt la Mer de France, au large du Golfe du Saint-Laurent, le Cap Breton et la Terre des Bretons au sud du fleuve.
Au début du 16ème siècle, au cours de campagnes de pêche à la morue, des navigateurs français, notamment basques, fréquentèrent les environs de Terre-Neuve. Ils ramenèrent en France quelques Amérindiens. En 1520, une colonie portugaise éphémère s’établit au Cap-Breton. En 1524, des marchands et le roi de France, François Ier, commanditèrent un explorateur florentin, Jean de Verrazane (ou Verrazzano - 1485-1528), pour trouver un passage par l'ouest vers l'Orient mystérieux. La France, qui s’était laissée distancer par d'autres pays européens dans la course aux découvertes, entendait combler son retard. L'expédition échoua, Verrazzano revint bredouille, après avoir exploré la côte américaine de la Floride à Terre-Neuve. Mais le mouvement était lancé et, sur les cartes de l'époque, apparurent bientôt la Mer de France, au large du Golfe du Saint-Laurent, le Cap Breton et la Terre des Bretons au sud du fleuve.
Les trois voyages de Jacques Cartier
Les trois voyages de Jacques Cartier (1491-1557), qui ont lieu de 1534 à 1542, marquent la première étape significative de l'histoire et de la formation de la Nouvelle-France. Au cours du premier voyage, le navigateur breton, natif de Saint-Malo, explore le fleuve Saint-Laurent, toujours à la recherche du passage qui permettrait d'atteindre le fabuleux Cathay de Marco Polo. Le 24 juillet 1534, il met pied à terre à Gaspé où il plante une croix, on ne sait trop où, prenant ainsi possession du littoral gaspésien au nom du roi de France. Il ramène en France deux des fils du chef iroquois de l'endroit, Donnacona, lequel voit les Européens arriver sur son territoire avec appréhension.
 Au cours du second voyage (1535-1536), Jacques Cartier baptise une petite baie où il fait relâche, le 10 août 1535, du nom du saint de ce jour là, Saint-Laurent, puis remonte le fleuve qui portera ultérieurement ce nom. Il découvre l'île aux Coudres, s'établit au havre Sainte-Croix, près du village indien de Stadaconé, à proximité de l'endroit où s'élèvera plus tard Québec, puis poursuit jusqu'à Hochelaga, une bourgade indienne fortifiée de palissades, située sur une île cultivée où pousse du blé d'inde, comme les Québécois continuent d'appeler le maïs. Jacques Cartier nomme la montagne où se trouve le village indien Mont Royal ; elle porte toujours ce nom et la ville de Montréal s'élève aujourd'hui à ses pieds ainsi que sur ses pentes.
Au cours du second voyage (1535-1536), Jacques Cartier baptise une petite baie où il fait relâche, le 10 août 1535, du nom du saint de ce jour là, Saint-Laurent, puis remonte le fleuve qui portera ultérieurement ce nom. Il découvre l'île aux Coudres, s'établit au havre Sainte-Croix, près du village indien de Stadaconé, à proximité de l'endroit où s'élèvera plus tard Québec, puis poursuit jusqu'à Hochelaga, une bourgade indienne fortifiée de palissades, située sur une île cultivée où pousse du blé d'inde, comme les Québécois continuent d'appeler le maïs. Jacques Cartier nomme la montagne où se trouve le village indien Mont Royal ; elle porte toujours ce nom et la ville de Montréal s'élève aujourd'hui à ses pieds ainsi que sur ses pentes.
Le Malouin y fait connaissance avec l'herbe à petun, le tabac des calumets, qu'il apprécie peu. Le voyage bute alors sur les rapides Lachine et il faut rebrousser chemin. Au cours du retour, Jacques Cartier contourne Terre-Neuve et prouve ainsi qu'il s'agit d'une île. Il ramène avec lui en France Donnacona, lequel mourra trois ans plus tard sans avoir revu son pays ; sont également du voyage quelques autres Iroquois, dans l'intention de les présenter à François Ier.
Le roi de France, alléché par les récits du chef indien, engage Jacques Cartier à entreprendre un troisième voyage, dans le but de rapporter de l'or, des pierres précieuses et des épices, mais aussi d'implanter une colonie et de propager le catholicisme. En occupant les terres découvertes, François Ier manifeste son intention de rejeter les prétentions de l'Autriche et du Portugal sur l'ensemble du Nouveau Monde. A cette fin, une expédition est montée ; elle doit être dirigée par un seigneur de la cour de France, Jean-François de la Roque de Roberval (1500-1560), natif de Carcassonne, nommé lieutenant-général de la Nouvelle-France.
Mais, comme l'expédition prend du retard, Jacques Cartier, qui ne goûte probablement pas le rôle de second qu’on lui impose, part le premier en 1541. La traversée est difficile ; un fort n'en est pas moins construit au confluent du Saint-Laurent et de la rivière du Cap Rouge, Charlesbourg-Royal, pour préparer la colonisation. En même temps, le navigateur se procure auprès des Indiens ce qu'il croit être de l'or et des diamants. En 1542, alors qu'il revient en France, il rencontre Roberval à Terre-Neuve. Celui-ci lui ordonne de retourner dans le Saint-Laurent ; le Breton refuse et rentre dans sa patrie où il se retrouvera bredouille, sa cargaison n'étant composée que de pyrite et de quartz sans valeur !
 En 1542, Roberval arrive au havre Sainte-Croix avec trois gros navires et une centaine de colons. L'hiver décime les nouveaux venus. En 1543, il explore le Saguenay à la recherche du merveilleux royaume que Donnacona et ses fils ont prétendu exister sur ses rives à François Ier. Il espère également découvrir un passage vers le nord-ouest jusqu'à la mer qui baigne les Indes. Cette exploration demeure vaine mais Roberval laisse son nom à une ville qui s'élève aujourd'hui sur les berges du Lac Saint-Jean. L'explorateur rentre en France ruiné, et la colonisation est temporairement abandonnée.
En 1542, Roberval arrive au havre Sainte-Croix avec trois gros navires et une centaine de colons. L'hiver décime les nouveaux venus. En 1543, il explore le Saguenay à la recherche du merveilleux royaume que Donnacona et ses fils ont prétendu exister sur ses rives à François Ier. Il espère également découvrir un passage vers le nord-ouest jusqu'à la mer qui baigne les Indes. Cette exploration demeure vaine mais Roberval laisse son nom à une ville qui s'élève aujourd'hui sur les berges du Lac Saint-Jean. L'explorateur rentre en France ruiné, et la colonisation est temporairement abandonnée.
Roberval a cependant remonté la rivière des Outaouais et son pilote, Jean Fontenaud ou Jean Alphonse de Saintonge (1484-1549), a démontré l'existence d'un détroit navigable entre le Groenland et le Labrador. Le pilote tentera de revenir sur les lieux toujours à la recherche d'un passage vers le nord-est. Les Espagnols enverront son navire par le fond, à une date indéterminée, alors qu'il rentre vers La Rochelle.
Les terres explorées ne paraissant recéler ni or ni diamant, on s'en désintéresse et on laisse leur approche aux pêcheurs, parmi lesquels des Français (Basques, Bretons et Normands) jusqu'à ce que le commerce des peaux n'attire à nouveau les convoitises. L'époque des Guerres de Religion ne favorise d’ailleurs guère les aventures maritimes.
La fondation de la Nouvelle-France par Samuel Champlain
 Un second voyage l'amène à l'embouchure du Saguenay. Il y rencontre le chef montagnais Anadabijou ; celui-ci accueille d'autant mieux le navigateur qu'un Indien qui revient de France dit le plus grand bien du roi Henry IV, et de sa bienveillance pour les gens de la race rouge. Le calumet de la paix est fumé. Cette première entente va influencer durablement la politique indigène de la France qui s'engage contre les Iroquois, une puissante confédération de cinq tribus, dont l'organisation inspirera plus tard la constitution des Etats-Unis.
Un second voyage l'amène à l'embouchure du Saguenay. Il y rencontre le chef montagnais Anadabijou ; celui-ci accueille d'autant mieux le navigateur qu'un Indien qui revient de France dit le plus grand bien du roi Henry IV, et de sa bienveillance pour les gens de la race rouge. Le calumet de la paix est fumé. Cette première entente va influencer durablement la politique indigène de la France qui s'engage contre les Iroquois, une puissante confédération de cinq tribus, dont l'organisation inspirera plus tard la constitution des Etats-Unis.Champlain remonte ensuite le fleuve jusqu'aux rapides pour en dresser la carte qu'il doit remettre au roi. De 1604 à 1607, le navigateur explore la côte américaine jusqu'à Cap Cod (Massachussetts) au cours d'une expédition dirigée par Pierre Dugua de Mons avec, une fois de plus, François Gravé comme pilote. Plusieurs établissements sont créés, dont Port-Royal ; c'est le début de l'Acadie. Mais les privilèges commerciaux accordés à Dugua de Mons ayant été révoqués, l'expédition revient en France en laissant Port-Royal à la garde du chef indien ami Membertou. La France entre sur ce point en compétition avec les Hollandais et les Anglais.
En 1598, Troillus des Mesgoüets ou Troilus de La Roche de Mesgouez (1536-1606), nommé gouverneur de Terre-Neuve par Henri III, puis Henry IV, embarque une quarantaine de mendiants qu'il dépose sur l'Île des Sables, qu'il baptise Île Bourbon, près de la Nouvelle-Ecosse actuelle. Presque tous mourront.
En 1608, Champlain repart comme lieutenant de Dugua de Mons, qui reste en France, avec vingt huit personnes de sexe masculin, dans le dessein de créer un établissement permanent. Il débarque au pied du Cap Diamant et fonde la ville de Québec, d'après le nom que les Montagnais ont donné au lieu, c'est-à-dire « Rétrécissement du fleuve ». Au cours du premier hivernage, la petite colonie est décimée par le scorbut et la dysenterie. Seul huit hommes survivent en plus de Champlain.
Celui-ci renforce son alliance avec les Montagnais et les Algonquins. Les relations avec ces derniers sont d'autant plus faciles qu'ils sont en conflit quasi permanent avec les Iroquois au sujet du commerce des fourrures. En 1609, Champlain remonte la rivière Richelieu et découvre le lac qui porte aujourd'hui son nom. Aucune mauvaise rencontre n'ayant eu lieu, une partie de la troupe quitte l'explorateur. Celui-ci reste seul avec deux Français et une soixantaine de Hurons. C'est alors, qu'à l'emplacement du futur fort Carillon, un peu au sud de Crown Point (Etat de New-York), l'expédition entre au contact des Iroquois. Le lendemain, deux cents guerriers sont sur le sentier de la guerre. Champlain tue un de leurs chefs d'un coup d'arquebuse semant la terreur parmi ses ennemis qui se débandent. Ce coup de feu marque le début d'une longue lutte qui opposera les Français, amis des Hurons, des Montagnais et des Algonquins, aux Iroquois alliés des Anglais.
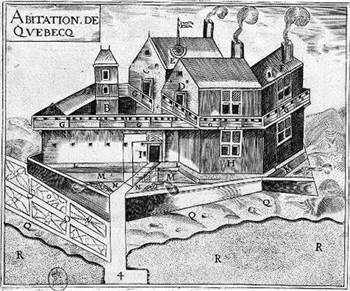 Champlain rentre en France avec l'espoir de relancer le commerce de la fourrure et d'intéresser les marchands à l'établissement de Québec. De retour au Canada, en 1610, il y est blessé d'une flèche à l'oreille et au cou, lors d'un nouvel affrontement avec les Iroquois, sur la rivière Richelieu. Le commerce des fourrures s'avérant désastreux et Henry IV étant mort assassiné, Champlain revient en France une fois de plus et s'y marie avec une jeune fille mineure (âgée de 12 ans). Il retourne au Canada en 1611 pour explorer les environs de l'île de Montréal, notamment la rivière des Prairies, et baptise une des îles du fleuve du nom de Sainte-Hélène, en l'honneur de sa jeune épouse. Un défrichement est entrepris dans le secteur de l'actuelle Place Royale, dans un endroit qui sert de lieu de rassemblement aux Indiens ; le site est protégé contre les crues par un muret de pierres. Champlain descend les rapides dans un canoë d'écorce pour asseoir son prestige sur les Indiens. Il revient en France en 1611 afin d'assurer l'avenir de son entreprise abandonnée par les marchands.
Champlain rentre en France avec l'espoir de relancer le commerce de la fourrure et d'intéresser les marchands à l'établissement de Québec. De retour au Canada, en 1610, il y est blessé d'une flèche à l'oreille et au cou, lors d'un nouvel affrontement avec les Iroquois, sur la rivière Richelieu. Le commerce des fourrures s'avérant désastreux et Henry IV étant mort assassiné, Champlain revient en France une fois de plus et s'y marie avec une jeune fille mineure (âgée de 12 ans). Il retourne au Canada en 1611 pour explorer les environs de l'île de Montréal, notamment la rivière des Prairies, et baptise une des îles du fleuve du nom de Sainte-Hélène, en l'honneur de sa jeune épouse. Un défrichement est entrepris dans le secteur de l'actuelle Place Royale, dans un endroit qui sert de lieu de rassemblement aux Indiens ; le site est protégé contre les crues par un muret de pierres. Champlain descend les rapides dans un canoë d'écorce pour asseoir son prestige sur les Indiens. Il revient en France en 1611 afin d'assurer l'avenir de son entreprise abandonnée par les marchands.
En 1612, Louis XIII nomme le comte de Soissons, futur prince de Condé, lieutenant-général en Nouvelle-France ; Champlain, avec le titre de lieutenant, le remplacera en son absence ; il exercera l'autorité de la couronne, continuera de rechercher un passage vers la Chine et d'exploiter les mines de métaux précieux qui viendraient à être découvertes. Dans ce cadre, dès 1613, le navigateur français entreprend un premier voyage vers le Pays d'en Haut par la rivière des Outaouais (Ottawa). Mais les informations qu'il obtient des Indiens le laissent dubitatif et il revient sur ses pas, après avoir perdu son astrolabe.
Les compagnies à charte
En 1616, après avoir amélioré les défenses de Québec, il repart pour la France. Le prince de Condé a été arrêté, et le maréchal de Thémines l'a remplacé avec le titre de vice-roi. Champlain plaide la cause du Canada auprès du pouvoir : le territoire contrôlé est immense, il est traversé par les plus belles rivières du monde, les Indiens ne demandent qu'à se convertir. Il suggère l'envoi de 15 Récollets, 300 familles de colons et 300 soldats. Il évalue le produit potentiel de la colonie à plus de 5 millions de livres. Les autorités sont convaincues et Champlain retrouve le monopole sur la traite des fourrures tandis que la poursuite de la colonisation est confirmée. En 1618, après avoir soumis à Louis XIII un plan d'évangélisation des Indiens, Champlain s'apprête à regagner la Nouvelle-France lorsque de nouvelles difficultés surgissent. Les Anglais ont obtenu la liberté du commerce et ses associés contestent son autorité.
En 1619, le prince de Condé, sorti de prison, cède sa vice-royauté au duc de Montmorency, amiral de France ; ce dernier confirme Champlain dans ses fonctions et le roi lui enjoint de maintenir la Nouvelle-France dans l'obéissance. Champlain retourne en Amérique avec sa femme devenue majeure. Il renforce encore les défenses de Québec en construisant le Fort Saint-Louis, en haut du Cap Diamant. Un conflit oppose sa compagnie à celle de traite des fourrures des frères Caën ; la dispute est réglée par la fusion des deux compagnies sous la direction des Caën. Champlain influence le choix du chef d'une tribu indienne et parvient à établir une paix précaire avec les Iroquois. En 1624, il revient en France avec son épouse. Encouragé à continuer, il repart bientôt, mais sans sa femme qui ne s'est jamais habituée à vivre parmi les Sauvages.
En 1627 Richelieu manifeste son intérêt pour la colonie en créant la Compagnie de la Nouvelle-France ou compagnie des Cent-associés, regroupement de marchands et d'aristocrates dont il est membre, ainsi que Champlain. Cette compagnie est chargée d'amener chaque année 300 colons. Le système des compagnies à charte bénéficiant du monopole de la traite des fourrures vient de voir le jour. Le régime seigneurial est introduit en Nouvelle-France. Champlain devient le commandant du cardinal dans la colonie.
 Mais les affaires se gâtent. En 1628, les Anglais pillent la ferme du Cap Tourmente. Champlain est sommé par des marchands britanniques, les Kirke, de traiter avec eux. Devant son refus, ils bloquent Québec. Les vivres manquent et Champlain, contraint de capituler, le 14 septembre 1629, est emmené captif à Londres. Le Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632) le libère en 1633. Réintégré comme commandant à Québec, en l'absence de son supérieur, comme antérieurement, il regagne la colonie que les Anglais restituent avec regret. Les Jésuites succèdent aux Récollets ; ils vont promouvoir la Nouvelle-France auprès des Français riches et cultivés.
Mais les affaires se gâtent. En 1628, les Anglais pillent la ferme du Cap Tourmente. Champlain est sommé par des marchands britanniques, les Kirke, de traiter avec eux. Devant son refus, ils bloquent Québec. Les vivres manquent et Champlain, contraint de capituler, le 14 septembre 1629, est emmené captif à Londres. Le Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632) le libère en 1633. Réintégré comme commandant à Québec, en l'absence de son supérieur, comme antérieurement, il regagne la colonie que les Anglais restituent avec regret. Les Jésuites succèdent aux Récollets ; ils vont promouvoir la Nouvelle-France auprès des Français riches et cultivés.
En 1634, Champlain relève les ruines, renforce les fortifications et charge Laviolette de fonder un nouveau poste à Trois-Rivières, à la demande du chef Algonquin Capitanal. Il envisage de reprendre l'offensive contre les Iroquois qui ne se tiennent pas tranquilles. Mais, en octobre 1635, il est frappé de paralysie et meurt le 25 décembre suivant. Dans le courant de la même année, les Jésuites ont ouvert le collège de Québec. La colonie compte encore moins de 200 habitants, mais la Nouvelle-France est fondée.
A la mort de Champlain, la Nouvelle-France existe mais elle est encore très faible. Il va falloir la maintenir en vie et la faire grandir dans un environnement hostile. En 1636, un nouveau gouverneur, Charles Jacques Huault de Montmagny (1583-1653), arrive dans la colonie. Il défait les Iroquois et conclut avec eux la Paix de Trois-Rivières (1645). Il contribue, avec les Jésuites, à l'agrandissement de la Nouvelle-France vers le nord et l'ouest. Par déformation de son nom, les Indiens le nomment Onontio (Grande Montagne), titre qui sera porté désormais par tous les gouverneurs français. Il est un des personnages de l'ouvrage de Cyrano de Bergerac : « L'Autre Monde » (1657).
La création de Montréal par Maisonneuve
En 1642, Maisonneuve arrive dans l'île de Montréal. Il est accompagné de la missionnaire laïque d'origine bourguignonne, Jeanne Mance, dont la vocation s'est forgée en soignant les victimes de la peste et de la Guerre de Trente ans. L'époque est favorable à la colonisation, Anne d'Autriche, épouse catholique du roi Louis XIII, régente de France à partir de 1643, soutenue par les Jésuites, encourage le développement de la Nouvelle-France ; pendant sa régence, sous le gouvernement de Mazarin, 1250 français, originaires des provinces de l'ouest, viennent peupler la colonie. Maisonneuve fonde Ville-Marie, au confluent du Saint-Laurent et de la petite rivière Saint-Pierre, sur un emplacement où les Autochtones se réunissent depuis des siècles. Il plante une croix au sommet du Mont Royal. Il entreprend la construction d'un fort. Jeanne Mance soigne les soldats et les bâtisseurs.
 En 1643, les Iroquois tuent trois colons près de Ville-Marie ; en 1644, les chiens de Maisonneuve débusquent les Iroquois cachés dans les environs de la ville, mais ils sont trop nombreux pour être chassés. En 1645, Jeanne Mance ouvre un modeste hôpital (6 lits pour les hommes et 2 pour les femmes), qui se développera par la suite, avec l'appoint des Sœurs hospitalières, à partir de 1659, et deviendra l'Hôtel Dieu de Montréal. Des religieux et des religieuses affluent pour évangéliser les Sauvages, dont Anne Compain de Sainte-Cécile, Anne Le Boutz de Notre-Dame, Madeleine de la Peltrie. Cette dernière fournit aux Jésuites les fonds nécessaire à la reconstruction de la petite église de bois édifiée à la hâte en 1615 à Tadoussac par le père récollet Dolbeau (1586-1652), qui a laissé son nom à une bourgade du Québec. Louis XIV fait don à cette première église en pierre construite au Canada, d'une cloche de bronze et d'une statue de l'enfant Jésus habillé d'une robe de soie brodée par sa mère, Anne d'Autriche, que l'on peut encore voir aujourd'hui.
En 1643, les Iroquois tuent trois colons près de Ville-Marie ; en 1644, les chiens de Maisonneuve débusquent les Iroquois cachés dans les environs de la ville, mais ils sont trop nombreux pour être chassés. En 1645, Jeanne Mance ouvre un modeste hôpital (6 lits pour les hommes et 2 pour les femmes), qui se développera par la suite, avec l'appoint des Sœurs hospitalières, à partir de 1659, et deviendra l'Hôtel Dieu de Montréal. Des religieux et des religieuses affluent pour évangéliser les Sauvages, dont Anne Compain de Sainte-Cécile, Anne Le Boutz de Notre-Dame, Madeleine de la Peltrie. Cette dernière fournit aux Jésuites les fonds nécessaire à la reconstruction de la petite église de bois édifiée à la hâte en 1615 à Tadoussac par le père récollet Dolbeau (1586-1652), qui a laissé son nom à une bourgade du Québec. Louis XIV fait don à cette première église en pierre construite au Canada, d'une cloche de bronze et d'une statue de l'enfant Jésus habillé d'une robe de soie brodée par sa mère, Anne d'Autriche, que l'on peut encore voir aujourd'hui.
Les guerres indiennes – Le massacre des religieux
En 1646, le père jésuite Isaac Jogue (1607-1646), qui a déjà été capturé et torturé par les Iroquois en 1642, est décapité par ces derniers qui le soupçonnent de sorcellerie ; son compagnon, Jean de la Lande (1620-1646), subit le même sort. En 1649, c'est au tour des missionnaires jésuites Jean de Brébeuf (1593-1649) et Gabriel Lallemant (1610-1649) de périr sous les coups des Iroquois. De 1642 à 1649, pas moins de huit religieux jésuites sont victimes des Indiens, sur les bords du lac Huron (aujourd'hui en Ontario) ; canonisés par le pape Pie XI, en 1930, ils sont collectivement les saints patrons du Canada sous le nom de Martyrs canadiens.
En 1651, les Iroquois attaquent l'hôpital de Jeanne Mance où Denis Archambeault (1630-1651) est tué par l'explosion de son canon, mais les défenseurs repoussent les assaillants après 12 heures de combat. En 1653, Maisonneuve revient de France avec une centaine de soldats, pour lutter contre les Iroquois. Il est accompagné d'une jeune champenoise, Marguerite Bourgeoys (1620-1700) ; cette dernière, tenaillée par la vocation religieuse, gagne la Nouvelle-France, après avoir rencontré Maisonneuve, lequel recrutait des gens en France pour développer la colonie. Pendant le voyage, elle a soigné à bord du navire les passagers victimes de la peste. Dès son arrivée au Nouveau Monde, elle s'apitoie sur les conditions de vie misérables de la population. En 1657, elle jette les fondations d'une première chapelle destinée plus tard à devenir Notre-Dame-de-Bon-Secours qui abrite aujourd'hui un musée dédié à sa fondatrice.
 La même année (1657), la guerre s'intensifie entre les Iroquois et la petite colonie française. Ville-Marie, qui compte encore moins de 400 habitants, est isolée. La traite des fourrures devient difficile. En 1658, Marguerite Bourgeoys ouvre néanmoins une première école, rue Saint Paul, à l'emplacement d'une vieille étable. La même année, Dollard des Ormeaux (1635-1660) débarque en Nouvelle-France. En 1659, après avoir recruté des institutrices en France, Marguerite Bourgeoys fonde la Congrégation religieuse de Notre-Dame de Montréal. Un vicaire apostolique, François de Laval (1623-1708), arrive à Québec, ce prélat remarquable va fortement contribuer à la propagation du catholicisme.
La même année (1657), la guerre s'intensifie entre les Iroquois et la petite colonie française. Ville-Marie, qui compte encore moins de 400 habitants, est isolée. La traite des fourrures devient difficile. En 1658, Marguerite Bourgeoys ouvre néanmoins une première école, rue Saint Paul, à l'emplacement d'une vieille étable. La même année, Dollard des Ormeaux (1635-1660) débarque en Nouvelle-France. En 1659, après avoir recruté des institutrices en France, Marguerite Bourgeoys fonde la Congrégation religieuse de Notre-Dame de Montréal. Un vicaire apostolique, François de Laval (1623-1708), arrive à Québec, ce prélat remarquable va fortement contribuer à la propagation du catholicisme.
Les Filles du Roy
Louis XIV encourage le peuplement de la colonie en accordant des terres le long du fleuve aux soldats qui s'y établissent. Malheureusement, ceux-ci préfèrent vivre à la façon des Sauvages plutôt que de défricher la forêt. En l'absence de femmes européennes, ils s'accouplent avec des squaws. La population se métisse et les anciens soldats du roi deviennent coureurs des bois. Pour les sédentariser, on imagine de leur envoyer des filles de France ; dès 1660, on recrute des volontaires et un millier de petites françaises courageuses, souvent orphelines, dotées par le roi, viennent s'établir dans les solitudes du Nouveau Monde ; on les appelle les Filles du Roy. Contrairement à une légende, elles ne sont pas toutes des filles de mauvaise vie, loin s'en faut. L'institution fondée par Marguerite Bourgeoys les accueille et surveille leurs fréquentations ; elle éduque les jeunes et leur apprend à tenir un foyer et une ferme. Elle aide aussi les colons à faire face aux époques de disette. Une hostellerie du Vieux Montréal, bâtie à l'intérieur des fortifications, en 1725, porte encore aujourd'hui leur nom.
 Dollard des Ormeaux est recruté par Maisonneuve qui lui confie le commandement du fort Ville-Marie. La menace d'une invasion iroquoise se précise. Le commandant du fort Ville-Marie décide de prendre les devants. Après une escarmouche où les Français ont le dessus, Dollar des Ormeaux et sa petite troupe, d'une quinzaine d'Européens renforcés par une quarantaine de Hurons et quatre Algonquins, s'installent dans un ancien poste algonquin abandonné au lieu-dit Long-Sault. Ils y sont bientôt assaillis par une nuée d'Iroquois. Une partie des Hurons fait défection ; ils ne sont d'ailleurs pas d'une grande utilité car le régime colonial français leur interdit la possession d'armes à feu.
Dollard des Ormeaux est recruté par Maisonneuve qui lui confie le commandement du fort Ville-Marie. La menace d'une invasion iroquoise se précise. Le commandant du fort Ville-Marie décide de prendre les devants. Après une escarmouche où les Français ont le dessus, Dollar des Ormeaux et sa petite troupe, d'une quinzaine d'Européens renforcés par une quarantaine de Hurons et quatre Algonquins, s'installent dans un ancien poste algonquin abandonné au lieu-dit Long-Sault. Ils y sont bientôt assaillis par une nuée d'Iroquois. Une partie des Hurons fait défection ; ils ne sont d'ailleurs pas d'une grande utilité car le régime colonial français leur interdit la possession d'armes à feu.
Les Français et leurs alliés se défendent avec vigueur causant d'énormes pertes dans les rangs ennemis jusqu'au moment où une grenade artisanale (ou un baril de poudre) explose au milieu des défenseurs. Dollard est tué. Désormais, toute résistance devient impossible. Les survivants sont massacrés sur place ; quelques-uns sont emmenés pour être torturés à mort et même mangés, selon certaines sources ; un seul parvient à s'échapper. Mais les pertes iroquoises sont si élevées qu'elles dissuadent provisoirement l'invasion projetée. Dollard des Ormeaux devient un héros de la Nouvelle-France, mais un héros aujourd'hui contesté car on pense, qu'en se portant au devant des Iroquois, son principal dessein était de leur tendre une embuscade pour s'emparer de leurs fourrures plutôt que de sauver la colonie. En 1661, les Iroquois attaquent à nouveau et tuent une centaine de Français.
La Nouvelle-France colonie royale
Le régime des compagnies à charte s'est révélé décevant et peu propre à développer la colonie dont le peuplement stagne. Aussi Louis XIV et Colbert décident-ils, en 1663, de transformer la Nouvelle-France en colonie royale ; la Compagnie des Cent-Associés est dissoute ; François de Laval fonde le Séminaire de Québec. En 1664, Louis XIV crée la Compagnie des Indes occidentales, dans un but commercial et d'évangélisation des Amérindiens ; elle ne durera pas plus de dix ans. En 1665, Maisonneuve disgracié, malgré les efforts qu'il a déployés, est rappelé en France, où il mourra oublié.
Désormais, La Nouvelle-France est administrée comme une province française. Le roi y dépêche un intendant, Jean Talon (1626-1694) qui s'efforce de diversifier l'économie locale, afin de rendre la colonie autosuffisante et surtout d'accroître sa population. En 1665, pour assurer la sécurité des colons, Louis XIV envoie le régiment de Carignan-Salières. Les Iroquois sont repoussés chez eux. Lors du premier recensement effectué, en 1666, l'intendant dénombre 3215 (d'autres disent 3418) habitants, dont 63% d'hommes. En 1672, Jeanne Mance pose une des pierres angulaires de la première église de Ville Marie. Elle décède un an plus tard, en odeur de sainteté, après avoir légué son cœur aux Montréalais. Elle repose dans la crypte de l'Hôtel-Dieu dont elle fut la fondatrice.
 Le gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), natif de Saint-Germain-en-Laye, joue un rôle très important dans l'évolution de la Nouvelle-France. Il est nommé une première fois gouverneur en 1672. Le départ de l'intendant Jean Talon, en novembre de la même année, lui confère pratiquement les pleins pouvoirs sur la colonie, jusqu'à l'arrivée, en 1675, d'un nouvel intendant, Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault (mort en 1696) ; les relations entre le gouverneur et l'intendant, qui reproche au premier de fermer les yeux sur le trafic de fourrures illicite des coureurs des bois, manqueront de cordialité.
Le gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), natif de Saint-Germain-en-Laye, joue un rôle très important dans l'évolution de la Nouvelle-France. Il est nommé une première fois gouverneur en 1672. Le départ de l'intendant Jean Talon, en novembre de la même année, lui confère pratiquement les pleins pouvoirs sur la colonie, jusqu'à l'arrivée, en 1675, d'un nouvel intendant, Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault (mort en 1696) ; les relations entre le gouverneur et l'intendant, qui reproche au premier de fermer les yeux sur le trafic de fourrures illicite des coureurs des bois, manqueront de cordialité.
Frontenac nomme La Vallière commandant de l'Acadie, entretient des relations avec Boston, assure l'alliance avec les Abénaquis et maintient la paix avec les Iroquois. Mais l'expansion de la colonie française prive ces derniers de territoires de chasse et gêne leurs communications avec les Anglais. En 1674, le diocèse de Québec voit le jour et François de Laval en devient l'évêque. En 1682, les intrigues de l'intendant, pour obtenir la disgrâce du gouverneur, entraînent le rappel des deux hommes en France.
En 1685, le nouvel intendant, Jacques Demeulle de la Source, instaure l'usage du papier-monnaie en réquisitionnant les cartes à jouer qui serviront par intermittence de billets de banque (monnaie de carte) jusqu'en 1714 ; avant le 19ème siècle, la monnaie métallique sera représentée indifféremment par les pièces françaises, anglaises, espagnoles, mexicaines et américaines. Après 1685, à la suite de la Révocation de l'Edit de Nantes, quelques protestants, convertis de manière plus ou moins forcée, qui souffrent de l'hostilité de leur voisinage en France, cherchent la tranquillité en se réfugiant sur les bords du Saint-Laurent. Vers 1688, le gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Callières (1648-1703), natif de Normandie, obtient une partie du terrain qui porte aujourd'hui le nom de Pointe-à-Caillères, au bord du fleuve ; il y érige sa résidence, à l’endroit où s'élève maintenant le Musée archéologique de Montréal.
Le massacre de Lachine – Les guerres intercoloniales
En 1689, Frontenac est replacé à la tête de la colonie. En son absence, la situation s'est dégradée. Les Anglais, alliés aux Iroquois, se montrent de plus en plus agressifs. Le gouverneur fait réoccuper le fort Frontenac, qu'il avait édifié en 1673, sur la lac Ontario. Il fortifie Québec et Montréal. Les Iroquois, armés par les Anglais, attaquent Lachine, massacrent des dizaines de colons et en emmènent encore plus en captivité ; le nombre des victimes, tués, blessés prisonniers n'est pas connu avec précision, on parle de plusieurs centaines ; ce qui est sûr, c'est que la férocité de l'attaque terrorise les habitants ; des femmes enceintes ont été éventrées pour extraire le fruit de leurs entrailles et des prisonniers ont été rôtis avant d'être dévorés. Cet acte barbare marque le début ce que l'on a appelé la Première Guerre intercoloniale (1689-1697). En mesure de représailles, une expédition française est montée contre le village anglais de Corlaer (Shenectady) dont 60 habitants sont tués et 25 autres emmenés comme prisonniers. La population de la Nouvelle-France s'élève alors à 15000 personnes et celle de la Nouvelle-Angleterre à 200000.
En 1690, les Anglais tentent de réduire la Nouvelle-France. L'amiral William Phips (1651-1695), un marin gouverneur du Massachusetts, prend le fort Pentagouet et Port-Royal en Acadie. Mais l'expédition contre Montréal échoue sur les bords du lac Champlain. La flotte de Phips assiège néanmoins Québec. Un ultimatum est adressé à Frontenac qui le repousse avec énergie. Les Anglais tentent un débarquement à Beauport et bombardent Québec. Mais Frontenac, qui a reçu un renfort envoyé de Montréal par M. de Callières, tient bon et, après trois jours d'efforts infructueux, les assaillants renoncent. Les Anglais, échaudés, chargeront dorénavant les Iroquois d'attaquer les Français à leur place.
 En 1692, Madeleine de Verchères (1678-1747), fille d'un seigneur de Nouvelle-France, défend mousquet en mains, pendant quatre jours, jusqu'à l'arrivée des renforts de Montréal, le fort de Verchères contre les attaques iroquoises. Par cet exploit, l'adolescente s'élève au rang d'une Jeanne Hachette ou d'une Jeanne d'Arc québécoise.
En 1692, Madeleine de Verchères (1678-1747), fille d'un seigneur de Nouvelle-France, défend mousquet en mains, pendant quatre jours, jusqu'à l'arrivée des renforts de Montréal, le fort de Verchères contre les attaques iroquoises. Par cet exploit, l'adolescente s'élève au rang d'une Jeanne Hachette ou d'une Jeanne d'Arc québécoise.
En 1693, une nouvelle incursion a lieu contre Montréal. Par ailleurs, les Iroquois essaient de se réconcilier avec les Outaouais ; une entente entre ces tribus porterait un grave préjudice au commerce français et une forte pression est exercée sur Frontenac pour que les villages iroquois soient détruits. Le gouverneur n'agit cependant pas sans le feu vert du ministre de la Marine. En 1696, une troupe de plus de 2000 hommes, tant de forces régulières que de milices et d'alliés indiens quitte Montréal pour le territoire iroquois. Mais l'ennemi a fuit après avoir incendié le village cible de l'attaque. On brûle les récoltes et on détruit tous les vivres trouvés aux alentours.
Frontenac poursuit l'expansion vers l'ouest, créant de nouveaux postes et nouant des contacts avec les Indiens des Prairies. En 1697, la paix de Ryswick est signée entre la France et l'Angleterre et la Nouvelle-France peut souffler un peu. Mais Frontenac n'a plus qu'une année à vivre. La prédominance anglaise sur la Baie d'Hudson est acquise. La France obtient la Baie James et recouvre Port-Royal.
En 1700, Marguerite Bourgeoys meurt en odeur de sainteté, après avoir offert sa vie pour sauver une jeune religieuse malade qui recouvre effectivement la santé ; elle est canonisée en 1982 par Jean-Paul II. Enfin, trois ans après la disparition de Frontenac, Louis-Hector de Callières, qui a succédé à Frontenac comme gouverneur, réussit le tour de force de réconcilier Iroquois et Algonquins, c'est la Grande Paix de Montréal (1701). Cette paix ne durera pas longtemps : la Guerre de Succession d'Espagne (1701-1713) éclate bientôt en Europe ; ce nouveau conflit entraîne en Amérique la Seconde Guerre intercoloniale (1702-1713).
La vie mouvementée d’un aventurier : Pierre-Esprit Radisson
La destinée mouvementée de Pierre-Esprit Radisson (1636-1710) fournit une illustration saisissante de ce qu'était la vie dans les territoires français d'Amérique du Nord au temps de Louis XIV. Arrivé en Nouvelle-France en 1652, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, Radisson tombe aux mains des Iroquois au cours d'un raid mené par ces derniers. Il est adopté par ses ravisseurs et passe deux ans en leur compagnie, se familiarisant avec leurs coutumes et leur mode de vie. Il revient ensuite parmi les Français, est recruté par Médard Chouart des Groseilliers (1618-1696), qui a épousé entre temps sa demi-sœur, et devient coureur des bois dans la région des Grands Lacs.
Les deux hommes ramènent beaucoup de fourrures qui leur sont confisquées par le gouverneur de la Nouvelle-France, pour lors Pierre de Voyer d'Argenson (1625-1709), au prétexte qu'ils n'ont pas de permis pour la traite des fourrures. Ils envisagent alors de lancer une entreprise commerciale en Baie d'Hudson mais, malgré un voyage en France de des Groseilliers, ils n'obtiennent pas l'appui escompté des autorités françaises.
 Ils tentent alors leur chance auprès des Britanniques à Boston. Le colonel George Cartwright, les emmène à Londres où il les présente au roi Charles II Stuart qui crée la Compagnie de la Baie d'Hudson à leur instigation. En 1668, ils partent pour la baie avec deux navires, l'Eaglet et le Nonsuch, affrétés par le prince Rupert, un esthète fortuné d'origine germanique, qui s'intéresse à l'Amérique du Nord, et qui deviendra le premier gouverneur de la Compagnie. Seul le Nonsuch, qui porte nos deux aventuriers, parvient à destination ; l'autre navire, avarié au cours d'une tempête, a regagné l'Angleterre.
Ils tentent alors leur chance auprès des Britanniques à Boston. Le colonel George Cartwright, les emmène à Londres où il les présente au roi Charles II Stuart qui crée la Compagnie de la Baie d'Hudson à leur instigation. En 1668, ils partent pour la baie avec deux navires, l'Eaglet et le Nonsuch, affrétés par le prince Rupert, un esthète fortuné d'origine germanique, qui s'intéresse à l'Amérique du Nord, et qui deviendra le premier gouverneur de la Compagnie. Seul le Nonsuch, qui porte nos deux aventuriers, parvient à destination ; l'autre navire, avarié au cours d'une tempête, a regagné l'Angleterre.
En 1674, de retour en Europe, insatisfaits du traitement que la Compagnie de la Baie d'Hudson leur a réservé, les deux aventuriers rencontrent à Londres un Jésuite d'origine auvergnate, prisonnier des Anglais, à la suite d'une mission envoyée auprès du gouverneur anglais Bayly par Frontenac. Ce religieux, le père Charles Albanel (1614-1696 - La bourgade québécoise d'Albanel porte son nom), a exploré la Baie d'Hudson en 1671, dans le cadre d'une expédition montée par l'intendant Jean Talon ; il les engage à revenir vers leur patrie d'origine.
Ils y sont fraîchement accueillis par Frontenac. Radisson entre malgré tout dans la marine royale française. En 1681, il est pressenti par un marchand de Nouvelle-France, Charles Aubert de La Chesnaye (1632-1702), l'homme le plus fortuné de Nouvelle-France, qui négocie l'obtention d'une charte pour la traite des fourrures, suite à la dissolution de la Compagnie des Indes occidentales, document qu'il obtient l'année suivante.
En 1682, Radisson participe au début de reconquête de la Baie d'Hudson par la France. Radisson et des Groseilliers s'engagent dans une expédition qui doit fonder un établissement à l'embouchure de la rivière Nelson pour le compte de la Compagnie du Nord de La Chesnaye. Ils font de nombreux prisonniers au nombre desquels John Bridgar, gouverneur de la colonie anglaise, et s'emparent d'un important lot de fourrures.
De retour à Québec, ils n'obtiennent pas, selon eux, la juste rémunération de leurs efforts. Le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, les envoie en France plaider leur cause. Radisson, frustré une fois de plus, change encore de camp et passe au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour laquelle il se bat contre les Français. Puis, de 1685 à 1687, il dirige le commerce à l'embouchure de Fleuve Nelson. Devenu citoyen anglais en 1687, Radisson rédige un récit de ses aventures avant de mourir en Grande-Bretagne dans la pauvreté. Une localité du nord du Québec et une station de métro de Montréal portent aujourd'hui son nom.
L’expansion de la Nouvelle-France en direction du Mississipi
Les gouvernorats de Frontenac sont marqués par la réussite d'explorations particulièrement marquantes. En 1673, Louis Jolliet (1645-1700), premier explorateur né dans la colonie, près de Québec, se lance dans l'exploration du bassin du Mississipi, à partir des Grands Lacs. On connaît l'existence du fleuve, que les Indiens appellent La Grande Rivière et que les Français ont baptisé la Rivière Colbert. Mais on pense alors qu'il débouche dans le Pacifique (Mer de Californie). L'expédition a été initiée par Jean Talon, qui souhaitait nouer une alliance avec les Indiens de cette région, mais Frontenac adhère à cette audacieuse entreprise. Au moment de s'y lancer, Jolliet s'associe le père jésuite Jacques Marquette, originaire de Laon (France), un auxiliaire précieux car il connaît le langage de plusieurs tribus indiennes.
Après avoir atteint un affluent du Mississipi, les deux explorateurs descendent celui-ci jusqu'au grand fleuve et le suivent jusqu'à l'embouchure de l'Ohio, à 1100 kilomètre de celle du Mississipi, et ils savent désormais que ce dernier aboutit au Golfe du Mexique. A partir de là, les choses commencent à se gâter ; Marquette ne comprend plus le langage des Indiens dont il apprend tout de même qu'ils sont en contact avec les Espagnols ; de plus, les interlocuteurs des explorateurs se montrent menaçants. Les deux hommes décident de revenir. Jolliet a rédigé des notes de voyage ; malheureusement, il fait naufrage au Sault-Saint-Louis, en amont de Montréal, et perd ses papiers.
N'ayant pas obtenu de Colbert l'autorisation de s'établir au pays des Illinois, Jolliet s'installe à Sept-Îles. En 1679, il est chargé par Frontenac d'une mission à la Baie d'Hudson. Le gouverneur anglais, Charles Baily, qui a entendu parler de ses exploits, le reçoit avec honneur. Il fonde des pêcheries sur l'archipel Mingan, au nord du Saint-Laurent, passe l'été sur l'île d'Anticosti et l'hiver à Québec, s’occupant de ses terres et de son commerce. En 1690, William Phips s'empare de sa barque, confisque ses marchandises et fait prisonnières sa femme et sa belle-mère.
Il passe les dernières années de sa vie à explorer la côte du Labrador et à la cartographier ; il enseigne au collège des Jésuites de Québec. Il meurt à une date imprécise, premier habitant de Nouvelle-France à avoir été connu internationalement de son vivant.
 En 1682, René Robert Cavelier de la Salle (1643-1687), natif de Rouen, et Henri de Tonti (1649-1704), un soldat italien au service de la France, descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son delta. Ils construisent le fort Prud'homme qui devient plus tard la ville de Memphis. L'expédition arrive à l'embouchure du Mississippi en avril ; Cavelier de La Salle y fait dresser une croix et une colonne portant les armes du roi de France : la souveraineté française s'étend désormais sur l'ensemble de la vallée du Mississippi, mais c’est une souveraineté largement virtuelle.
En 1682, René Robert Cavelier de la Salle (1643-1687), natif de Rouen, et Henri de Tonti (1649-1704), un soldat italien au service de la France, descendent à leur tour le Mississippi jusqu’à son delta. Ils construisent le fort Prud'homme qui devient plus tard la ville de Memphis. L'expédition arrive à l'embouchure du Mississippi en avril ; Cavelier de La Salle y fait dresser une croix et une colonne portant les armes du roi de France : la souveraineté française s'étend désormais sur l'ensemble de la vallée du Mississippi, mais c’est une souveraineté largement virtuelle.
L'expédition repart par le même chemin vers la Nouvelle-France et Cavelier de La Salle retourne à Versailles. Là, il convainc le ministre de la Marine de lui accorder le commandement de la Louisiane. Il fait croire que celle-ci est proche de la Nouvelle-Espagne en dessinant une carte sur laquelle le Mississippi paraît beaucoup plus à l'ouest que son cours réel. Il met sur pied une nouvelle expédition, mais celle-ci tourne au désastre : Cavelier de La Salle ne parvient pas à retrouver le delta du Mississippi et se fait assassiner en 1687.
Il appartiendra à Pierre Le Moyne d'Iberville (1661-1706), natif de Ville-Marie, de relever le flambeau. Ce dernier, fils de deux colons normands émigrés, d'abord destiné à la prêtrise mais manquant de vocation, est devenu militaire par inclination. Entré dans la marine royale, il a participé en 1686, à une expédition dans la Baie d'Hudson, sous les ordres du chevalier Pierre de Troyes (1645-1688), en remontant en canots la rivière des Outaouais, depuis Montréal, puis en poursuivant le chemin en traîneaux à chiens jusqu'à la Baie James. L'expédition réussit au-delà des espérances ; elle s'empare du fort Monsoni, rebaptisé fort Saint-Louis, puis du fort Rupert et même d'un voilier, Le Craven. D'Iberville rentre à Québec par la mer, chargé de fourrures et de marchandises anglaises.
L'année suivante, d'Iberville, nommé capitaine de la frégate Le Soleil d'Afrique, retourne en Baie d'Hudson avec le dessein de fermer aux Anglais l'accès à la rivière Nelson, en faisant tomber le fort York ; il arraisonne deux navires et capture 80 Anglais. En 1690, il assiège le fort New Severn que la garnison fait sauter avant de s'enfuir. En 1694, il prend enfin le fort York.
Frontenac donne ensuite l'ordre au marin français de patrouiller le long des côtes de l'Atlantique, depuis Terre-Neuve jusqu'à la Nouvelle Angleterre. En 1696, d'Iberville détruit le fort William Henry (Maine) puis remonte vers Terre-Neuve où il attaque les villages et pêcheries anglaises de la côte est de l'île, pillant et brûlant les maisons et ramenant de nombreux prisonniers. A la fin de l'expédition, en 1697, il ne reste plus aux Anglais que deux bourgades dans l'île ; trente six de leurs colonies ont été détruites ; et, pour couronner la campagne, d'Iberville se paie le luxe de triompher de trois navires de guerres ennemis: il en coule un, s'empare du second et le troisième ne doit son salut qu'à la fuite.
 Ce brillant capitaine est alors choisi par le ministre de la Marine pour diriger une expédition chargée de redécouvrir et d'explorer l'embouchure du Mississipi, là où Cavelier de la Salle a échoué une dizaine d'années plus tôt. D'Iberville construit le fort Maurepas, en 1699, à proximité de la ville actuelle d'Ocean Springs. En 1700 et 1701, il bâtit les forts Mississipi et Saint-Louis. La Louisiane, appelée ainsi en l'honneur de Louis XIV, vient réellement de naître. Avant de s'en éloigner, d'Iberville noue des alliances avec les Autochtones, afin d'assurer la pérennité de cette nouvelle conquête française. En 1706, il met la main sur l'île anglaise de Nevis, dans les Caraïbes. Il se rend de là à La Havane, quérir des renforts espagnols pour attaquer la Caroline. Mais, atteint de la fièvre jaune, il décède dans le port de la capitale cubaine, où il est inhumé.
Ce brillant capitaine est alors choisi par le ministre de la Marine pour diriger une expédition chargée de redécouvrir et d'explorer l'embouchure du Mississipi, là où Cavelier de la Salle a échoué une dizaine d'années plus tôt. D'Iberville construit le fort Maurepas, en 1699, à proximité de la ville actuelle d'Ocean Springs. En 1700 et 1701, il bâtit les forts Mississipi et Saint-Louis. La Louisiane, appelée ainsi en l'honneur de Louis XIV, vient réellement de naître. Avant de s'en éloigner, d'Iberville noue des alliances avec les Autochtones, afin d'assurer la pérennité de cette nouvelle conquête française. En 1706, il met la main sur l'île anglaise de Nevis, dans les Caraïbes. Il se rend de là à La Havane, quérir des renforts espagnols pour attaquer la Caroline. Mais, atteint de la fièvre jaune, il décède dans le port de la capitale cubaine, où il est inhumé.
Progressivement, les Français ont imposé leur présence le long du Mississipi, construisant des forts et des postes de traite aux points stratégiques, jetant ainsi les bases de la reconnaissance de l'ouest mystérieux et enfermant les Anglais dans leurs possessions de la côte atlantique. Mais cet immense territoire n'est pratiquement pas peuplé et la position de la France reste précaire.
En 1711, alors que la Guerre de succession d'Espagne bat son plein en Europe, l'amiral Hovenden Walker (1666-1728) monte une expédition contre Québec avec des effectifs considérables : 5300 soldats et 6000 marins. Mais des vents violents drossent une partie de la flotte sur une île ; l'expédition est un échec. En 1713, les Traités d'Utrecht ramènent la paix sur le continent européen et en Amérique : la France cède à l'Angleterre l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson. En 1714, le gouverneur Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725) décide de protéger Montréal et Québec par des enceintes fortifiées de pierre qui ne seront achevées que longtemps après sa mort.
La Nouvelle-France a été fondée par une poignée d’individus où la proportion de militaires, de missionnaires, d’explorateurs et d’aventuriers était sans doute disproportionnée par rapport à celle des laboureurs. Ces individus se sont mêlés aux Indiens et en ont adopté parfois les mœurs pour devenir coureurs des bois. Ils n’ont pas été ménagés par leurs adversaires mais, bien qu’en situation de faiblesse numérique, ils ont résisté avec opiniâtreté. Habitués à faire face, les échecs et les calamités ne les ont pas rebutés. Ils ont tracé l’esquisse d’un vaste empire, mais se sont malheureusement montrés plus soucieux d’en repousser les limites que de le peupler. Ces origines vont peser lourd dans l’histoire de la colonie et dans celle du Québec.
Heurs et malheurs de l’Acadie
Voyons maintenant rapidement ce qui s'est passé du côté de l'Acadie. On l'a vu, celle-ci naît en 1604 pour disparaître trois ans plus tard, à la suite d'un différend commercial. En 1610, quelques colons sont de retour. Mais, en 1613, Samuel Argall ( ?-1626), de Virginie, s'empare du territoire et en chasse la population. En 1621, le gouvernement anglais baptise le territoire Nouvelle-Ecosse et y fait venir des colons écossais. En 1631, Charles de la Tour (1593-1666), lieutenant-général de l'Acadie pour le roi de France, construit des forts au cap Sable et à Saint-Jean.
L'année suivante, le Traité de Saint-Germain-en-Laye attribue le territoire à la France. Environ 300 colons français remplacent les Ecossais. La mort du gouverneur Razilly (1587-1635), cousin du cardinal de Richelieu, entraîne une guerre civile entre les deux prétendants à la succession : de La Tour et Charles de Menou d'Aulnay (1604-1650), cousin de Razilly. Port-Royal est alors la capitale de la colonie française. D'Aulnay, qui voit l'avenir de l'Acadie dans l'agriculture, favorise la venue de nouveaux colons.
Après sa mort, un nouveau conflit éclate entre la France et l'Angleterre. En 1654, l’Acadie est conquise par les Anglais. Mais le Traité de Bréda, en 1667, la restitue à la France. A partir de 1670, Port-Royal essaime, donnant naissance à deux villages : Beaubassin et Grand-Pré. En 1690, William Phips, conquiert une fois de plus le pays, qui retourne à la France lors de la paix de Ryswick, sept ans après. Par le Traité d'Utrecht, en 1713, l'Acadie est cédée définitivement à l'Angleterre et redevient la Nouvelle-Ecosse. Les Acadiens sont autorisés à gagner des territoires français ; la plupart restent sur place.
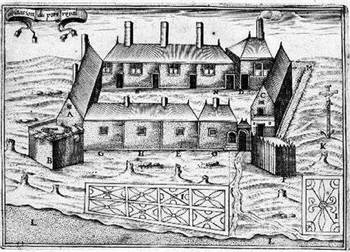 En 1720, les Français construisent la forteresse de Louisbourg, sur l'île Royale (ou du Cap-Breton). Une importante immigration gonfle la population et, lors de la Guerre de succession d'Autriche (1740-1748), qui déclenche en Amérique la Troisième Guerre intercoloniale (1744-1748), les Français tentent en vain de reconquérir l'Acadie. C'est au contraire les Anglais qui prennent Louisbourg, en 1745. A la fin du conflit, le Traité d'Aix-la-Chapelle (1748) attribue l'île Saint-Jean (ou Île-du-Prince-Édouard) et l'île Royale à la France, ce qui est perçu comme un affront par les Anglais. En 1749, ils répliquent en créant Halifax, avec l'apport de 2000 colons. La situation ne cesse de s'envenimer, Anglais et Français se disputant l'allégeance des Acadiens et construisant des forts en préparation d'une nouvelle guerre.
En 1720, les Français construisent la forteresse de Louisbourg, sur l'île Royale (ou du Cap-Breton). Une importante immigration gonfle la population et, lors de la Guerre de succession d'Autriche (1740-1748), qui déclenche en Amérique la Troisième Guerre intercoloniale (1744-1748), les Français tentent en vain de reconquérir l'Acadie. C'est au contraire les Anglais qui prennent Louisbourg, en 1745. A la fin du conflit, le Traité d'Aix-la-Chapelle (1748) attribue l'île Saint-Jean (ou Île-du-Prince-Édouard) et l'île Royale à la France, ce qui est perçu comme un affront par les Anglais. En 1749, ils répliquent en créant Halifax, avec l'apport de 2000 colons. La situation ne cesse de s'envenimer, Anglais et Français se disputant l'allégeance des Acadiens et construisant des forts en préparation d'une nouvelle guerre.
Le Grand Dérangement
En 1755, pour régler définitivement la question, le gouverneur de la Nouvelle Ecosse, Charles Lawrence (1709-1760), décide la déportation massive des Acadiens. On tient d'abord la mesure secrète, afin qu'ils ne s'enfuient pas avec leur bétail. L'opération est ensuite conduite avec une grande brutalité. On les entasse dans des bateaux envoyés vers le sud (Massachusetts, Connecticut, Maryland...), dans des Etats où ils sont mal accueillis voire refoulés et conduits à errer sans asile ou encore assignés à résidence comme des criminels, ou bien encore ils sont transférés en Angleterre, où on les traite en prisonniers de guerre. Ceux qui cherchent à s'échapper sont fusillés. Beaucoup gagnent des territoires voisins sous juridiction française, au risque d'être chassés à nouveau, par suite des aléas de l'histoire.
Plusieurs milliers reviennent en France, notamment dans le Poitou. D'autres se rendent en Louisiane ou aux Antilles ; d'autres encore atterrissent aux Malouines, puis en Amérique du Sud. Beaucoup se réfugient au Nouveau Brunswick. Ceux dont la présence demeure tolérée en territoire britannique sont condamnés à vivre en parias, à l'écart, sur les terres les moins fertiles, en évitant tout regroupement jugé trop important par les autorités, sous peine de travaux forcés. D'après des historiens américains, ce nettoyage ethnique, qualifié de Grand Dérangement, entraîna la mort de 7500 à 9000 personnes sur les 12000 à 18000 habitants que comptait l'Acadie. Il traumatisa les autres habitants de la Nouvelle-France dont il marqua pour longtemps la conscience collective. La chute de Louisbourg, en 1758, sonne le glas définitif de la colonisation française sur le territoire actuel des Provinces Maritimes.
Revenons maintenant au bord du Saint-Laurent. Au début du règne de Louis XV, l'expansion de la Nouvelle-France se poursuit. Mais on parle de plus en plus de Canada et de moins en moins de Nouvelle-France. L'Acadie est perdue depuis 1713, mais les possessions françaises sont encore immenses. Seulement, il devient de plus en plus évident qu'elles manquent d'assises solides du fait d'un peuplement insuffisant. Elles comptent encore moins de 20000 habitants alors qu'il y en a plus de 400000 en Nouvelle-Angleterre ! Les Français, bénéficiant d'un pays tempéré et d'une agriculture prospère, n'émigrent pas volontiers, à la différence d'autres peuples européens moins bien lotis. A partir de 1730, 648 personnes condamnées pour délits mineurs sont déportées en Nouvelle-France. Mais c’est insuffisant ; il est facile de prévoir que la colonisation française pourra difficilement s'imposer face à une colonisation anglaise beaucoup plus dense et que la question se règlera certainement, en dehors du vœu des populations locales, sur le théâtre des affrontements européens.
L’expansion de la Nouvelle-France vers l’ouest
Les explorations de la première période du règne sont l'œuvre de Pierre Gaultier de Varennes de La Vérendrye (1685-1749). Natif de Trois-Rivières, cet homme entreprenant est le fils d'un officier du régiment de Carignan-Salières. Elève du petit  séminaire de Québec, il commence sa vie de soldat à 12 ans, comme cadet à l'académie navale. Au début des années 1700, il fait ses premières campagnes, notamment à Terre-Neuve contre les Anglais. En 1706, il est nommé enseigne en second. Il entre dans les troupes coloniales à 20 ans, puis sert en Europe pendant la Guerre de Succession d'Espagne ; blessé et fait prisonnier à Malplaquet, en 1709, il est promu au grade de lieutenant. De retour en Nouvelle-France, en 1712, il se livre à l'agriculture et à l'élevage, sans abandonner ses fonctions militaires. En 1715, il obtient la permission d'ouvrir un comptoir pour traiter avec les Indiens et commence à se détourner des travaux agricoles, en s'associant à un de ses frères qui commande un poste dans la région du lac Supérieur.
séminaire de Québec, il commence sa vie de soldat à 12 ans, comme cadet à l'académie navale. Au début des années 1700, il fait ses premières campagnes, notamment à Terre-Neuve contre les Anglais. En 1706, il est nommé enseigne en second. Il entre dans les troupes coloniales à 20 ans, puis sert en Europe pendant la Guerre de Succession d'Espagne ; blessé et fait prisonnier à Malplaquet, en 1709, il est promu au grade de lieutenant. De retour en Nouvelle-France, en 1712, il se livre à l'agriculture et à l'élevage, sans abandonner ses fonctions militaires. En 1715, il obtient la permission d'ouvrir un comptoir pour traiter avec les Indiens et commence à se détourner des travaux agricoles, en s'associant à un de ses frères qui commande un poste dans la région du lac Supérieur.
En 1729, fort des renseignements qu'il a obtenu des Indiens, il sollicite du gouverneur de la Nouvelle-France, Charles de Beauharnais de la Boische (1671-1749), une aide financière en vue de partir à la découverte de la mer de l'ouest, dont parlent les Indiens, le Pacifique. L'intendant, Gilles Hocquart (1694-1783), et le gouverneur appuient sa requête auprès du roi. L'autorisation de monter une expédition lui est accordée, mais sans aide financière. Il doit donc s'endetter pour financer le projet, mais il compte rembourser sa dette en construisant des forts de traite de fourrures le long du chemin ; il obtient d'ailleurs le monopole de la traite des fourrures pour trois ans.
En 1731, il est prêt à partir en compagnie de trois de ses fils et quelques autres personnes. L'expédition se dirige vers le lac Supérieur, puis le lac à la Pluie. Le fort Saint-Pierre est construit. En 1732, un poste secondaire s'élève sur la Rivière-Rouge. En 1734, alors que La Vérendrye revient à Montréal dédommager ses créanciers, d'autres membres de l'expédition marchent vers le lac Winnipeg où ils construisent le fort Maurepas. Malheureusement, alors que le chef de l'expédition revient vers l'ouest, un de ses fils ainsi qu'un Jésuite, le père Jean-Pierre Alneau de la Touche (1705-1736), et 19 compagnons sont tués par des Sioux sur le sentier de la guerre au lac des Bois. Les survivants continuent d'avancer vers l'ouest.
En 1738, ils érigent le fort La Reine sur la rivière Assiniboine et le fort Rouge à l'emplacement actuel de Winnipeg. Ils bifurquent ensuite vers le sud et pénètrent dans le territoire de l'actuel Dakota, au pays des Mandanes. Déçu de ne pas rencontrer de rivière coulant en direction de la mer de l'ouest, contrairement aux dires des Indiens, La Vérendrye revient à Montréal tandis que ses fils poursuivent vers la rivière Saskatchewan, les lacs Manitoba et Winnipeg. En 1741, de retour, il décide la construction des forts Dauphin, sur le lac Manitoba, et Bourbon, au nord du lac Winnipeg.
Ces deux forts seront établis en 1742. En même temps, deux de ses fils s'enfoncent vers l'ouest, remontent le Missouri, puis la rivière Yellowstone et parviennent jusqu'aux Rocheuses, que leurs guides indiens refusent de franchir sous prétexte qu'ils se trouveraient alors en territoire ennemi. Tout le monde rentre à Montréal opportunément car les autorités françaises commencent à s'interroger sur les motivations réelles de La Vérendrye : la découverte de nouveaux territoires ou le commerce lucratif des fourrures ?
Cinq ans plus tard, peu de temps avant sa mort, Pierre Gaultier obtient du roi la Croix de Saint-Louis, suprême récompense, une seigneurie héréditaire et le grade de capitaine. Il a fait reculer les frontières de la Nouvelle-France jusqu'au Manitoba et, en transformant une partie des Grands Lacs en mers intérieures françaises, il a détourné vers le Saint-Laurent une bonne part du trafic des fourrures qui passait jusqu'alors par la Baie d'Hudson anglaise.
Pendant ce temps, que s’est-il passé dans la colonie ? En 1721, un violent incendie détruit une grande partie de Montréal. L'intendant Michel Bégon de la Picardière (1669-1747), natif de Blois, petit cousin par alliance de Colbert, intendant de Nouvelle-France depuis 1710, ordonne que les maisons soient reconstruites en pierre. La pierre étant plus coûteuse que le bois, cette ordonnance oblige les moins fortunés à quitter la ville ; des faubourgs commencent à se développer à l'extérieur de l’enceinte. En 1730, François Poulin de Francheville, seigneur de Saint-Maurice (1692-1733), crée les Forges Saint-Maurice. Mais l'expérience tourne court ; le fondateur de l'entreprise disparaît prématurément et l'Etat devient propriétaire de la Compagnie en 1743.
En 1734, un nouvel incendie détruit l'Hôtel-Dieu de Montréal et une quarantaine de résidences ; on accuse (probablement à tort) une esclave noire, Marie-Josèphe, dite Angélique ; condamnée à mort, elle est pendue en public puis brûlée. La colonie vit essentiellement de la traite des fourrures qui représente 70% de ses exportations. Elle est toujours considérée en France comme un moyen d'écouler les produits de la métropole pour engranger de l'argent : mercantilisme oblige. Cependant l'orage se prépare. Les colonies anglaises veulent en finir avec les possessions françaises. C'est d'ailleurs en partie parce qu'elles craignaient leur intervention dans le conflit qu'elles ont si impitoyablement dispersé les Acadiens. Au milieu du siècle, la colonie française compte 85000 habitants, la politique de peuplement a donc porté ses fruits, essentiellement d'ailleurs en raison d'une forte natalité, mais c'est insuffisant car la Nouvelle-Angleterre compte près de 1,5 millions d'habitants.
Le guet-apens de Washington
En 1747, Rolland-Michel Barrin (1693-1756), comte de La Galissonière, gouverneur intérimaire de la Nouvelle-France, milite ardemment pour la création d'une chaîne de postes reliant le Canada à la Louisiane, en suivant la vallée de l'Ohio, qui devient ainsi un lieu de friction privilégié entre Français et Anglais. En même temps, il s'efforce de maintenir sur leur territoire les Abénakis alliés de la France, de manière à assurer une zone tampon entre le Canada et l'Acadie.
En 1754, George Washington (1732-1799), depuis peu promu lieutenant-colonel, recrute une petite armée et se dirige sur l'Ohio. Il surprend un parti français commandé par Joseph Coulon de Villiers, sieur de Jumonville (1718-1754), un officier militaire canadien français né à Verchères, simplement en reconnaissance. Les circonstances de l'engagement restent obscures ; on dit que les blessés et les prisonniers furent froidement achevés. Cet assassinat pèsera sur la mémoire du chef de l'indépendance américaine ; il explique en partie la froideur avec laquelle les Canadiens français accueilleront la révolution américaine. Le meurtre de Jumonville constitue le premier acte de la Guerre de Sept ans, que l'on appelle Guerre de la Conquête, en Amérique.
De la guerre de conquête à la chute de la Nouvelle-France
 En 1756, Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de Montcalm (1712-1759), natif de Nîmes, arrive au Canada, ex-Nouvelle-France, avec trois mille hommes, pour commander les troupes françaises. Il accepte mal d'être subordonné au marquis Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal (1698-1778), natif de Québec, fils d'un précédent gouverneur, gouverneur à son tour. Les premières campagnes de Montcalm contre les Britanniques sont couronnées de succès. Il accroît les défenses du fort édifié sur le lac Champlain. Il capture et détruit le fort Oswego, sur le lac Ontario. Il triomphe au fort William Henry en 1757. Il remporte encore une victoire inespérée au fort Carillon, en 1758. On le récompense en le nommant lieutenant général.
En 1756, Louis Joseph de Montcalm-Gozon, marquis de Montcalm (1712-1759), natif de Nîmes, arrive au Canada, ex-Nouvelle-France, avec trois mille hommes, pour commander les troupes françaises. Il accepte mal d'être subordonné au marquis Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal (1698-1778), natif de Québec, fils d'un précédent gouverneur, gouverneur à son tour. Les premières campagnes de Montcalm contre les Britanniques sont couronnées de succès. Il accroît les défenses du fort édifié sur le lac Champlain. Il capture et détruit le fort Oswego, sur le lac Ontario. Il triomphe au fort William Henry en 1757. Il remporte encore une victoire inespérée au fort Carillon, en 1758. On le récompense en le nommant lieutenant général.
Québec, assiégée par l'Anglais Wolfe, résiste pendant près de trois mois, en 1759. Mais, le 13 septembre, sur les Plaines d'Abraham, Montcalm est mortellement blessé alors que son armée défaite bat en retraite : il mourra avant que les Anglais ne s'emparent du pays qu'il avait pour mission de défendre. Son adversaire, le général anglais, lui aussi touché mortellement, l'accompagne dans l'autre monde. Québec tombe. Les rescapés se réfugient à Montréal. En 1760, sous les ordres de Lévis, les Français lancent une contre-offensive. Ils remportent la victoire de Sainte-Foy. Les Anglais se retranchent derrière les remparts de Québec ; ils résistent jusqu'à l'arrivée de leur flotte qui contraint Lévis à lever le siège. Au cours des combats, Jean Vauquelin (1728-1772), un officier de marine né à Dieppe, se couvre de gloire avec sa frégate l'Atalante, échouée à la Pointe-aux-Trembles ; il résiste jusqu'au bout à la flotte anglaise et son bateau n'est plus qu'une épave lorsqu'il est fait prisonnier, après avoir réussi à faire débarquer la plupart de ses hommes ; les Anglais, fortement impressionnés, le laissent rentrer en France.
Trois colonnes de troupes anglaises convergent vers Montréal, dernier bastion de la résistance française, l'une en provenance de Québec, l'autre depuis le lac Champlain et la troisième par le cours supérieur du Saint-Laurent. Toute résistance est vouée à l'échec. En effet, la flottille chargée de vivres et de renforts venant de France, sous les ordres de François Chenard de La Giraudais (1727-1776), après avoir essuyé bien des épreuves au cours de la traversée, a été contrainte de se réfugier dans la Baie des Chaleurs, puis dans la rivière Ristigouche où, après plusieurs jours de furieux combats contre la marine anglaise, elle s'est sabordée, le 8 juillet. Le 1er septembre, le fort Chambly, construit en bois en 1665, contre les Iroquois, et rebâti en pierre en 1709, contre les Anglais, tombe aux mains de ces derniers. Vaudreuil, dernier gouverneur du Canada français, capitule le 8 septembre 1760, tandis que Lévis brûle ses drapeaux. Les Amérindiens alliés des Français ont capitulé quelques jours plus tôt au fort La Présentation. Douze jours plus tard, la reddition de Trois-Rivières met un point final à la grandiose aventure coloniale française en Amérique.
Vaudreuil sera d'abord traduit en justice, puis acquitté. Qui est donc responsable de la perte des possessions françaises ? Certains auteurs désignent Montcalm qui n'aurait pas su les défendre efficacement. D'autres incriminent la mauvaise conduite des derniers intendants, comme François Bigot (1703-1778), natif de Bordeaux, qui trafiquait des fourrures et des armes entreposées dans l'immeuble joliment baptisé La Friponne , pour s'enrichir au détriment du fisc, et qui fut embastillé après son rappel en France ! Mais c'est plus vraisemblablement le déséquilibre démographique déjà signalé, le désintérêt de l'opinion publique française pour ces « arpents de neige » et surtout la défaite de nos armes en Europe qui expliquent le désastre. Le Traité de Paris, qui met fin à la Guerre de Sept ans, en 1763, attribue la Nouvelle-France à l'Angleterre ; seules les îles Saint-Pierre et Miquelon restent françaises ; la Louisiane, opportunément espagnole depuis 1762, échappe aux convoitises anglaises ; elle redeviendra française en 1800, mais Napoléon la vendra aux États-Unis en 1803, conscient de son incapacité à la défendre ; l'aventure américaine de la France aura alors pris fin.
Après la chute de la Nouvelle-France, plus de 2000 colons français retournent dans leur patrie d'origine : ceux qui ont les moyens de payer leur passage. Les autres demeurent au pays espérant que la mère patrie reviendra un jour à la faveur d'une victoire en Europe sur l'Anglais redouté et honni. Ils sont 60 à 65000 et ils constituent la source principale des quelques 7,8 millions de Québécois francophones d'aujourd'hui et de tous ceux, presque aussi nombreux, que les vicissitudes de l'histoire ont poussé à émigrer dans les autres provinces du Canada où aux Etats-Unis.
La tentative d’assimilation
En attendant mieux, ils se serrent autour de leurs églises et commencent à mettre en œuvre la politique qualifiée de revanche des berceaux en multipliant les naissances pour noyer les Anglais dans un océan d'adversaires. La population va doubler à chaque génération. Monseigneur Jean-Olivier Briand (1715-1794), évêque de Québec, ordonne à ses ouailles de reconnaître le roi d’Angleterre comme leur souverain mais le clergé, en même temps, encourage la natalité.
L'application des lois britanniques ne se fait pas attendre. Dès 1763, Marie-Josephte Corriveau (1733-1763), condamnée à mort pour avoir assassiné son mari qui la maltraitait, est pendue et sa dépouille exposée aux regards de la population dans une cage de fer ; un tel supplice, incompatible avec les mœurs françaises, frappe les Canadiens : la Corriveau se métamorphose en personnage du folklore québécois !
L'Angleterre octroie une constitution, sous forme d'une Proclamation royale, au territoire conquis devenu « The province of Quebec » ; ce texte prévoit l'assimilation à plus ou moins long terme des colons français ; la loi anglaise s'applique à tous, aussi bien au civil qu'au pénal ; la langue officielle est l'anglais, la religion le protestantisme. Les catholiques ont le droit de conserver leur religion, mais ils doivent la renier, par le serment du test, s'ils se portent candidats à un poste dans l'Administration ; par cette mesure, les catholiques sont exclus des emplois officiels ; le gouverneur, James Murray (1721-1794), en est réduit à confier ces emplois à des personnes incompétentes !
La capitulation de Montréal prévoit d'étendre aux tribus amérindiennes alliées des Français les avantages concédés à ces derniers. Ces tribus ne s'en révoltent pas moins contre l'occupant britannique, sous la direction du chef outaouais Pontiac, essentiellement pour la conservation de leurs terres ; le clergé francophone invite ses fidèles à aider l'occupant britannique à réduire la révolte indienne qui est écrasée. En 1764, commence la publication d'un journal bilingue : La Gazette de Québec ; une pétition circule déjà dans les milieux francophones pour dénoncer le régime britannique tandis que les Anglophones réclament la création d'une assemblée pour les représenter. En 1768, Guy Carlton, baron Dorchester (1724-1808), succède à James Murray, comme gouverneur ; il se montre favorable à une réforme revenant aux lois et coutumes françaises et hostile à la création d'une assemblée.
La Guerre d’indépendance des Etats-Unis
En 1775 commence la Guerre d'indépendance des Etats-Unis. Ce soulèvement d'anciens vétérans des guerres contre la Nouvelle-France ne suscite que très peu de sentiments favorables parmi la population canadienne qui n'a oublié ni la déportation des Acadiens ni l'assassinat de Jumonville ; la devise du Québec ne sera-t-elle pas plus tard : « Je me souviens ». Aussi, lorsque les Américains tentent de rallier à leur cause les habitants de la province, ils sont loin d'être accueillis à bras ouverts. Ils trouvent néanmoins quelques partisans, assez pour former deux régiments (747 miliciens) qui se distingueront à Saratoga (1777) et à Yorktown (1781). Parmi ces partisans, on peut citer un commerçant prospère de Montréal, qui fut aussi juge de paix, Pierre Calvet, propriétaire de la maison qui abrite aujourd'hui l'Hostellerie des Filles du Roy. Pour dissuader toute velléité de soutien aux Insurgents américains, Monseigneur Jean-Olivier Briand rappelle aux catholiques leur serment d'allégeance au roi d'Angleterre, le trahir serait pêcher !
Dirigés par Richard Montgomery (1738-1775) et Benedict Arnold (1741-1801), les Américains, guidés par leurs partisans, envahissent la province du Québec et occupent la région de Montréal, où le château de Ramezay, aujourd'hui converti en musée, leur sert de quartier général. Mais, en 1776, ils échouent dans leur tentative de prendre Québec où Montgomery est tué. Benjamin Franklin (1706-1790) honore son ami Pierre Calvet d'une visite ; il est à Montréal pour sonder les intentions des Canadiens ; il en repart avec le sentiment qu'il serait plus facile d'acheter la province que de la conquérir. Les renforts britanniques, composé de mercenaires allemands, arrivent en grand nombre et chassent bientôt les Insurgents.
La reconnaissance de la spécificité québécoise
Cependant, la Guerre d'indépendance américaine, va marquer profondément l'avenir du Québec. D'abord, dès 1774, conscients du danger que représenterait pour l'empire britannique un soulèvement conjoint des Insurgents américains et des Canadiens, les Anglais ont révoqué la Proclamation royale émise une dizaine d'années plus tôt. Par l'Acte de Québec, le territoire de la province est délimité d'une manière extensive : de la Gaspésie jusqu'aux Grands Lacs ; une entité recouvrant grosso-modo le Québec et l'Ontario voit ainsi le jour ; par ailleurs, l'abolition du serment du test réhabilite le catholicisme tandis que la langue, le droit français et le régime seigneurial d'antan sont restaurés ; la spécificité des Canadiens français est ainsi reconnue. Les Anglophones protestent contre ces dispositions favorables aux Francophones.
Une autre conséquence de la révolution américaine influencera encore plus durablement l'avenir du Canada ; les Américains ne rejettent en effet pas unanimement la soumission à l'Angleterre ; celle-ci conserve ses partisans. Ces derniers se trouvent évidemment en butte à l’hostilité des Insurgents ; ils se réfugient dans les territoires restés sous contrôle britannique, les provinces maritimes, où ils contribuent à chasser les derniers Acadiens, et aussi la province du Québec où les Francophones, qui sont maintenant 90000, voient déferler, sur le territoire qu'on vient de leur reconnaître, quelques 50000 Loyalistes brandissant l'Union-Jack. Ces Américains, demeurés fidèles au roi d'Angleterre, vont peupler ce qui deviendra l'Ontario, mais un grand nombre d'entre eux s'établissent aussi sur le territoire du Québec actuel, en particulier en Estrie, où ils fonderont la ville de Sherbrooke, et où existe encore, à Lennoxville, la seule université anglicane d'Amérique du Nord. On les installe sur des terres confisquées aux Canadiens français et aux Indiens.
En 1778, la France prend officiellement partie pour les Insurgents américains, en envoyant un corps expéditionnaire de 6000 hommes, aux ordres de Rochambeau (1725-1807), rejoindre Lafayette (1757-1834) et quelques autres membres de la noblesse française qui se battent déjà par idéal auprès des partisans de l’indépendance américaine. Les Canadiens reprennent espoir ; peut-être le retour de la vieille mère-patrie est-il proche. L'amiral d'origine auvergnate Charles-Henri d'Estaing (1729-1794) encourage cet espoir en diffusant un manifeste, affiché à la porte des églises, dans lequel il invite les Français d'Amérique à s'allier aux Etats-Unis, à la grande colère du gouverneur Frederick Haldimand (1718-1791), d'origine suisse et francophone. Malheureusement, malgré la victoire franco-américaine, si le Traité de Versailles, en 1783, reconnaît bien l'indépendance des Etats-Unis, il oublie purement et simplement les Français d'Amérique qui, compte tenu de l'arrivée des Loyalistes, porteront désormais le nom de Canadiens français. Décidément, les « arpents de neige » n'intéressent personne en Europe. La désillusion est immense et sera durable.
La Révolution française et l’Empire
Malgré leur rancune à l'encontre de la mère-patrie, les Canadiens français accueillent la Révolution française avec enthousiasme. Dès 1789, on parle de l'événement le plus important du monde depuis l'avènement du christianisme. Mais, après la chute de la monarchie, l'opinion bascule et devient majoritairement hostile, en grande partie sous l'influence du clergé. Les autorités ecclésiastiques insistent sur fait que, le roi de France n'existant plus, c'est au roi d'Angleterre que l'on doit maintenant fidélité. De son côté, la propagande britannique dissocie habilement la France des hommes qui la dirigent et insiste sur la nécessité de combattre ces infernaux suppôts de l'Antéchrist.
La séparation du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec)
Parallèlement, l'Angleterre revoit sa copie coloniale. Pour permettre aux Loyalistes de jouir des droits qui étaient les leurs avant la révolution américaine, comme ils le réclament, et aussi pour éviter de les noyer dans la masse des Francophones, Pitt, dès 1791, sépare le Canada en deux parties distinctes: le Haut-Canada, majoritairement anglophone, et encore peu peuplé, et le Bas-Canada, majoritairement francophone, où l'on compte déjà environ 160000 descendants des anciens colons français. L'Ontario et le Québec voient le jour, même si l'on parle encore seulement de Canada. L'Acte constitutionnel de 1791 dote le Bas-Canada d'une Assemblée consultative, élue au suffrage censitaire, et accorde même le droit de vote aux femmes (elles le perdront en 1834 pour ne le retrouver qu'en 1940). Un Francophone, Jean Antoine Panet (1751-1815) est le premier président élu de cette assemblée. Tout le monde n'est cependant pas dupe et les esprits éclairés comprennent que l'Angleterre instrumentalise la crise politique en France pour renforcer sa domination sur le Canada. En 1794, les Francophones rejettent le projet de création d'une milice et, en 1796, ils refusent l'entretien de la voierie devant leur porte, qu'une nouvelle loi leur impose ; l'adoption d'une loi sur les ponts et les chemins cause même une émeute.
Malgré l'apparente désaffection de l'opinion canadienne française pour la Révolution, l’occupant britannique redoute toujours que les idées subversives ne se propagent dans la population francophone. En 1793, un mémoire défendant la reconquête du Canada n'a-t-il pas été soutenu devant la Convention nationale de Paris ? En 1794, une Association pour le maintien des lois, de la constitution et du gouvernement du Bas-Canada est formée pour dépister les foyers révolutionnaires. L'arrivée d'émigrés, dont 51 prêtres réfractaires, renforce le climat contre-révolutionnaire. Pour éviter toute contamination de l'extérieur, les frontières sont sévèrement contrôlées et des mesures d'exception sont prises contre les étrangers que l'on filtre soigneusement. Un Américain, soupçonné de complot, David MacLane est pendu à titre d'exemple. Cette situation durera jusqu'à la fin du Premier Empire que sert un général de brigade originaire de Québec : François Joseph d’Estienne de Chaussegros de Lery (1754-1824).
La tranquillité sociale est d'abord favorisée par la relative prospérité dont jouit le Canada à cette époque. La culture des céréales se développe stimulée par le prix élevé du blé à l'exportation. Mais, en 1801, de mauvaises récoltes conjuguées à l'effondrement du commerce des fourrures, qui cesse d'être l'activité économique dominante, causent des difficultés pendant les années suivantes. L'Institution royale d'écoles gratuites vise à angliciser l'ensemble de la population.
Un problème fiscal contribue, en 1805, à dresser les deux communautés fondatrices du Canada l'une contre l'autre ; pour financer la construction de prisons, va-t-on instituer une taxe sur les importations ou sur la propriété foncière ? Dans le premier cas, ce sont les Anglophones qui vont payer, dans le second, ce sont les Francophones. C'est la première solution qui est retenue, au grand dam des Anglophones, dont la presse se déchaîne. Toujours en 1805, des banques canadiennes commencent à imprimer leurs premiers billets ; l'évêque anglican Jacob Mountain (1749-1825) estime devoir être le seul à porter ce titre, ce qui est jeter un énorme pavé dans le jardin du catholicisme. Un journal anglophone The Quebec Mercury tourne les Francophones en ridicule. Une pétition est adressée à Napoléon pour l'appeler au secours du Canada, mais elle ne recueille que 12 signatures ; a contrario, une souscription est lancée pour l'érection à Montréal d'un monument à Horatio Nelson (1758-1805) qui vient d'être tué en remportant la victoire de Trafalgar.
En 1806, La création du journal Le Canadien, organe du Parti canadien, de tendance libérale, fondé au début du siècle, n'est sans doute pas étrangère à la polémique déclenchée par le financement des prisons ; on notera le titre de ce premier organe de presse francophone, il est significatif : on ne parle pas encore du Québec. Un nouveau conflit religieux s'élève entre les Francophones et la couronne britannique. Le nombre de prêtres est notoirement insuffisant et le déficit ne fait que s'accroître. L'évêque catholique de Québec, Joseph-Octave Plessis (1763-1825), en poste à partir de 1806, bataille ferme contre le gouverneur et l'évêque anglican pour garder son titre et pour obtenir une division des diocèses, de manière à suivre l'évolution de la démographie ; mais il se heurte aux réticences de Londres.
Le Règne de la Terreur
En 1807, James Henry Craig (1748-1812) devient gouverneur de l'Amérique du Nord britannique ; assisté d'un secrétaire fanatique, il inaugure l'ère qualifiée de Règne de la Terreur pendant laquelle les « traitres » sont maintenus en prison sans jugement. Persuadé que le Bas-Canada est un foyer de sédition, il s'efforce de contrôler la composition de son Assemblée et écarte les Francophones des emplois publics. Il multiplie les dissolutions de l'Assemblée et emprisonne même un candidat, François Blanchet (1776-1830), pendant les élections. En 1809, la couronne britannique détache le Labrador du Québec ; c'est un nouveau sujet de contestation. Une mesure à caractère antisémite expulse un commerçant juif, Ezekiel Hart (1770-1843), de l'Assemblée qui est dissoute.
En 1810, l'Assemblée réclame le contrôle de la liste civile, elle est à nouveau renvoyée devant les électeurs ; le journal Le Canadien est interdit et ses rédacteurs (Bédard, Blanchet, Taschereau) sont arrêtés pour sédition. Mgr Plessis engage ses fidèles à demeurer loyaux au roi d'Angleterre et il condamne la doctrine du Parti canadien ; en récompense de son engagement politique, l'évêque de Québec reçoit un traitement de mille livres du gouvernement britannique. Les élections à l'Assemblée désavouent le gouverneur et le haut clergé. Craig recommande au roi l'union du Haut et du Bas-Canada.
 De 1812 à 1814, une nouvelle guerre oppose l'Angleterre aux Etats-Unis. Ces derniers essaient, une fois de plus, de conquérir le Canada. Mais ils rencontrent encore moins de succès qu'en 1775-1776 auprès de la population francophone. Le 26 octobre 1813, leurs troupes avancent le long de la rivière Châteauguay dans l'intention de s'emparer de Montréal. Charles-Michel de Salaberry (1778-1829), à la tête de ses voltigeurs Canadiens français les attend à la hauteur d'Allan's Corners. Les envahisseurs reçoivent une réception si chaude qu'ils ne tenteront plus jamais d'envahir le Canada.
De 1812 à 1814, une nouvelle guerre oppose l'Angleterre aux Etats-Unis. Ces derniers essaient, une fois de plus, de conquérir le Canada. Mais ils rencontrent encore moins de succès qu'en 1775-1776 auprès de la population francophone. Le 26 octobre 1813, leurs troupes avancent le long de la rivière Châteauguay dans l'intention de s'emparer de Montréal. Charles-Michel de Salaberry (1778-1829), à la tête de ses voltigeurs Canadiens français les attend à la hauteur d'Allan's Corners. Les envahisseurs reçoivent une réception si chaude qu'ils ne tenteront plus jamais d'envahir le Canada.
L'économie du Bas-Canada poursuit son évolution : le commerce des fourrures ne représente plus que 9%, le Haut-Canada étant plus favorable à sa culture, le blé régresse au profit de l'avoine et du fourrage, la culture de la pomme de terre se développe, tandis que se maintiennent celles des pois et des fèves (les fèves au lard sont un plat traditionnel), du chanvre, du lin et du maïs. En 1816, le Bas-Canada subit sa pire récolte depuis le début du siècle. En 1817, la Banque de Montréal voit le jour et, l'année suivante, c'est au tour de la Banque de Québec.
En 1815, Le gouverneur George Prevost (1767-1816), en poste depuis 1811, est rappelé à Londres, à la demande de la bourgeoisie anglaise qui lui reproche sa bienveillance à l'égard du Parti canadien. Il est remplacé par un homme plus énergique, John Coape Sherbrooke (1764-1830).
Toujours en 1815, Louis-Joseph Papineau (1786-1871), un avocat natif de Montréal, est élu orateur, c'est-à-dire président, de l'Assemblée du Bas-Canada, à laquelle il appartiendra pendant 28 ans et qu'il présidera pendant 22 ans ; cet homme politique éminent va jouer un rôle fondamental dans l'évolution des Canadiens français ; sa maison à Montréal ainsi que son manoir à Montebello existent encore aujourd'hui. La société canadienne française est toujours régie par des règles antérieures à la Révolution française ; Papineau prône l'abolition du régime seigneurial.
L’organisation de la résistance
En 1817, Sherbrooke obtient du gouvernement britannique la reconnaissance officielle de l'Eglise catholique du Canada, en récompense des positions prises par Mgr Duplessis. En 1822, les Canadiens anglais militent pour un acte d'union des deux Canadas qui éliminerait la langue française. Papineau, alors président de l'Assemblée, et J. Neilson, un journaliste francophile, vont à Londres pour s'opposer à ce projet, munis d'une pétition comportant 60000 signatures. Le Bas-Canada compte alors 420000 habitants et le Haut-Canada 125000. Une forte immigration irlandaise pose des problèmes sociaux.
En 1825, le gouverneur George Ramsay Dalhousie (1770-1838), excédé par les nombreux conflits qui l'opposent à l'Assemblée, se rend à son tour dans la capitale britannique dans le but de faire modifier la constitution de 1791. Pendant son absence, son subalterne, le lieutenant-gouverneur Francis Nathaniel Burton (1766-1832), s'entend avec le Parti canadien, ce qui rend caduque l'initiative du gouverneur que ce compromis rend furieux. A cette époque, la population québécoise est à 90% rurale. Toujours en 1825, le Canal Lachine est inauguré. Le commerce du bois joue alors un rôle éminent dans l'économie régionale.
 En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote ; Louis-Joseph Papineau, partisan de réformes constitutionnelles, dans le cadre de la légalité, et hostile à la lutte armée, en devient le chef. En 1827, Dalhousie dissout l'Assemblée et convoque de nouvelles élections dans l'intention de se débarrasser de Papineau ; mais les électeurs déjouent la manœuvre. L'Assemblée demande à Londres la destitution du gouverneur.
En 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote ; Louis-Joseph Papineau, partisan de réformes constitutionnelles, dans le cadre de la légalité, et hostile à la lutte armée, en devient le chef. En 1827, Dalhousie dissout l'Assemblée et convoque de nouvelles élections dans l'intention de se débarrasser de Papineau ; mais les électeurs déjouent la manœuvre. L'Assemblée demande à Londres la destitution du gouverneur.
Un nouveau gouverneur, James Kempt, plus accommodant, succède à Dalhousie, en 1828. En 1829, à la suite d'un conflit politique entre l'Assemblée et le Conseil législatif, désigné par la couronne, un défaut de crédit entraîne la fermeture des écoles qui venaient juste d'ouvrir. En 1830, un nouveau gouverneur, Matthew Whitworth-Aylmer (1775-1850), entre en fonction. C'est un militaire sans expérience administrative ; il se montre incapable de gérer les exigences croissantes des Canadiens français et exacerbe les tensions en favorisant les Canadiens anglais. Le Parti patriote se radicalise : il ne se contente plus d'une Assemblée sans pouvoir et exige le contrôle des finances de la colonie ; par ailleurs, il se brouille avec le clergé. Une immigration anglophone vigoureuse gonfle la population canadienne et tend à modifier l'équilibre démographique jusqu'alors favorable aux Francophones.
En 1831, une épidémie de choléra, qui sévira aussi l'année suivante, décime la population (2723 morts à Québec et 2547 à Montréal). En 1833, on compte 400000 Francophones au Canada. Cette même année, l'abolition de l'esclavage ne soulève aucun problème, celui-ci étant resté résiduel dans la colonie française. En 1834, les radicaux du Parti patriote l'emportent sur les modérés et gagnent les élections avec 77% des suffrages ; ils rédigent 92 résolutions qui demandent, pour le Bas-Canada, un gouvernement responsable, l'élection du Conseil exécutif et davantage de Canadiens français dans l'Administration du pays. Ces requêtes, envoyées à Londres, tombent au plus mauvais moment, l'Angleterre traversant une crise politique. Le gouverneur cesse de réunir une Assemblée devenue incontrôlable. Une forme de communautarisme se développe alors dans la colonie: les Canadiens français se rassemblent dans la Société Saint-Jean Baptiste, un saint dont la fête sera celle du Québec; les autres communautés ethniques créent leurs propres sociétés.
En 1835, la détérioration de la situation entraîne le rappel d'Aylmer. Un nouveau gouverneur, Archibald Acheson, comte Gosford (1776-1849), arrive avec une mission de conciliation. Les Anglophones mécontents fondent le belliqueux Doric Club (une version du British Rifle Corps) ; les Francophones répliquent en créant Les Fils de la Liberté, dont l'homme politique canadien George-Etienne Cartier (1814-1873), un des futurs pères de la confédération, est l'un des 500 fondateurs.
La rébellion des patriotes
En 1837, le rejet des 92 résolutions met le feu aux poudres. Londres leur oppose en effet 10 résolutions, parmi lesquelles figure le droit de l'exécutif à utiliser sans contrôle l'argent de l'Etat, ce qui constitue une véritable provocation. Malgré la dénonciation du radicalisme par la hiérarchie catholique et les réticences de Papineau, l'agitation fait tache d'huile à travers le Bas-Canada. Fils de la liberté et membres du Doric Club en viennent aux mains à Montréal. Le commandement des troupes est confié à John Colborne (1778-1863) et Gosford quitte ses fonctions.
 La répression militaire s'abat sur les patriotes. Vingt six mandats d'arrêt pour crime de haute trahison sont émis contre eux. La tête de Papineau, pourtant hostile aux émeutes, est mise à prix ; il se réfugie d'abord aux Etats-Unis, puis en France ; il ne sera amnistié qu'en 1845. Des affrontements armés ont lieu, à Saint-Denis, où les patriotes triomphent, et dans Saint-Charles, où ils sont battus ainsi que dans le village de Saint-Eustache, au nord de Montréal, dont l'église garde encore la marque des boulets anglais. La bataille de Saint-Eustache immortalise Jean-Olivier Chénier (1806-1837), une des figures patriotiques les plus emblématiques. Ce médecin de Saint-Eustache, engagé dans le mouvement révolutionnaire, est général en chef du comté des Deux-Montagnes. Alors que Joseph Papineau prêche la modération, Chénier lance un appel aux armes ; dès lors, sa tête est mise à prix. En décembre 1837, il commande quelques deux cents hommes retranchés dans l'église, le presbytère et le couvent de Saint-Eustache, pour résister à l'armée britannique. La partie n'est pas égale. Les morts sont bientôt nombreux parmi les patriotes. Les Anglais triomphent et Chénier est tué au moment où il sort de l'église en flammes.
La répression militaire s'abat sur les patriotes. Vingt six mandats d'arrêt pour crime de haute trahison sont émis contre eux. La tête de Papineau, pourtant hostile aux émeutes, est mise à prix ; il se réfugie d'abord aux Etats-Unis, puis en France ; il ne sera amnistié qu'en 1845. Des affrontements armés ont lieu, à Saint-Denis, où les patriotes triomphent, et dans Saint-Charles, où ils sont battus ainsi que dans le village de Saint-Eustache, au nord de Montréal, dont l'église garde encore la marque des boulets anglais. La bataille de Saint-Eustache immortalise Jean-Olivier Chénier (1806-1837), une des figures patriotiques les plus emblématiques. Ce médecin de Saint-Eustache, engagé dans le mouvement révolutionnaire, est général en chef du comté des Deux-Montagnes. Alors que Joseph Papineau prêche la modération, Chénier lance un appel aux armes ; dès lors, sa tête est mise à prix. En décembre 1837, il commande quelques deux cents hommes retranchés dans l'église, le presbytère et le couvent de Saint-Eustache, pour résister à l'armée britannique. La partie n'est pas égale. Les morts sont bientôt nombreux parmi les patriotes. Les Anglais triomphent et Chénier est tué au moment où il sort de l'église en flammes.
Les victimes de la répression sont nombreuses. L'armée britannique brûle le village de Saint-Benoît. La Constitution du Bas-Canada est suspendue. Les échecs ne découragent cependant pas les patriotes qui se regroupent aux Etats-Unis, bien décidés à prendre leur revanche. Ils pénètrent dans la province et proclament la République, la séparation de l’Église et de l’État, la suppression de la dîme, l’abolition des redevances seigneuriales, la liberté de la presse, le suffrage universel pour les hommes, le scrutin secret, la nationalisation des terres de la couronne et celles de la British American Land Co., l’élection d’une Assemblée constituante et l’emploi des deux langues dans les affaires publiques.
En 1838, le successeur de Gosford, John George Lambton, comte Durham (1792-1840), profite de l'accès au trône de la reine Victoria pour amnistier 153 rebelles, tandis que 8 chefs de l'insurrection sont exilés aux Bermudes ; critiqué à Londres, il démissionne. Colborne reprend l'affaire en mains ; il proclame la loi martiale, repousse les patriotes venus des Etats-Unis et lutte contre les Frères chasseurs, un mouvement clandestin qui donne du fil à retordre aux forces britanniques en Montérégie. Les arrestations sont nombreuses ; une cour martiale est instituée pour juger 108 accusés. En 1839, douze patriotes sont pendus dans une prison de Montréal ; cinquante-huit autres sont déportés en Australie ; des écrivains et imprimeurs sont emprisonnés pour écrits séditieux.
La révolte ne s'est pas limitée au Bas-Canada ; elle s'inscrit en fait dans le vaste mouvement d'émancipation des nations qui agite l'Europe. Mais la tentative de Mackenzie, en Haut-Canada, dans une région dominée par les Loyalistes, n'a revêtu qu'une importance secondaire, et elle n'en a été que plus facilement réprimée. Nombre de vaincus s'enfuient aux Etats-Unis. Le Parti patriote change une fois de plus de nom, il devient désormais le Parti libéral. L'emprise des libéraux sur l'opinion publique est refoulée au profit d'un retour en force de l'influence cléricale. L'Eglise excommunie les patriotes qui seront réhabilités au 20ème siècle.
 L'image légendaire du patriote, sabots aux pieds, pipe au bec, fusil à l'épaule, taille serrée dans une ceinture fléchée, tuque (bonnet en laine à pompons) en tête, n'en restera pas moins populaire au Québec. Elle refleurira dans les années 1970, au moment de l'essor du mouvement indépendantiste. Les patriotes ne se rassemblaient pas derrière le drapeau bleu et blanc frappé de fleurs de lys, qui n'apparut que plus tard. Leur étendard était tricolore : vert, blanc rouge, comme celui de l'Italie. Il est intéressant de souligner qu'ils se sont inspirés de la Révolution française plutôt que de l'exemple américain pourtant voisin.
L'image légendaire du patriote, sabots aux pieds, pipe au bec, fusil à l'épaule, taille serrée dans une ceinture fléchée, tuque (bonnet en laine à pompons) en tête, n'en restera pas moins populaire au Québec. Elle refleurira dans les années 1970, au moment de l'essor du mouvement indépendantiste. Les patriotes ne se rassemblaient pas derrière le drapeau bleu et blanc frappé de fleurs de lys, qui n'apparut que plus tard. Leur étendard était tricolore : vert, blanc rouge, comme celui de l'Italie. Il est intéressant de souligner qu'ils se sont inspirés de la Révolution française plutôt que de l'exemple américain pourtant voisin.
Notons que le pourcentage des professions intellectuelles est plus faible dans la population francophone (0,12 %) que dans la population anglophone (0,34%) et que les intellectuels francophones occupent souvent un emploi inférieur à leur compétence. Un problème social s'ajoute donc au problème politique. Il refera surface un siècle plus tard.
Le retour à la politique d’assimilation – La création du Canada
L'échec du soulèvement est suivi par une importante réforme constitutionnelle en 1840. Cette réforme s'inspire du rapport rédigé par Lord Durham à la suite de la prise d'armes, document dans lequel les Canadiens français sont présentés comme un peuple inférieur, sans histoire et sans culture. Cette opinion restera répandue chez les Anglophones jusqu'à une époque récente. François-Xavier Garneau (1809-1866) réplique à cette grossière falsification de la réalité en rédigeant une « Histoire du Canada » qui fait justice des calomnies anglaises, lesquelles ne poursuivent qu'un seul but : servir d'alibi à la réduction en quasi esclavage des Canadiens français.
Quoi qu'il en soit, un Acte d'Union réunit le Haut et le Bas-Canada dans un seul gouvernement du Canada. Les Assemblées des deux entités précédentes disparaissent. Elles sont remplacées par une Assemblée du Canada unique où Francophones et Anglophones sont représentés à parité. Les Francophones vont se battre pour obtenir une représentation proportionnelle, mais on ne leur accordera pas celle-ci avant que l'immigration n'ait rendu les Anglophones majoritaires ; la balance est pour le moment favorable aux Canadiens français (ils sont encore 20% plus nombreux que les Canadiens anglais), mais cela ne durera pas car une forte immigration anglophone va inverser la position respective des deux communautés dès 1851.
Un gouverneur-général administre la colonie. C'est l'acte de naissance d'un Canada, dont la langue officielle redevient l'anglais. On notera que ce Canada, limité à l'Ontario et au Québec actuels, ne comprend ni les provinces maritimes, ni Terre-Neuve, ni évidemment les provinces de l'ouest qui ne sont pas encore colonisées. La révolte, comme c'est souvent le cas, s'est donc accompagnée d'une régression au détriment des Canadiens français dont l'identité culturelle et linguistique est menacée. La volonté assimilationniste des Anglais se manifeste à nouveau, comme lors de la conquête. Cette réforme, qui entre en application en 1841, ne satisfait personne et elle s'avère rapidement source d'instabilité politique : les gouvernements, installés à Montréal en 1843, se succèdent rapidement. Les nouvelles institutions soulèvent toutefois peu d'opposition parmi les Francophones, encore sous le coup de la répression.
La Grande Hémorragie des Canayens
Cependant, les Canadiens anglais usurpent le nom de Canadiens que se donnaient jusqu'à présent les Canadiens français ; ces derniers, pour se distinguer des Canadians, s'appellent donc Anciens Canadiens ou Canayens. Les plus hostiles émigrent aux Etats-Unis, tant d'ailleurs pour des raisons économiques que politiques ; ils sont si nombreux que l'on nomme cette époque celle de La Grande Hémorragie. Ce mouvement de population négatif est contrebalancé par une forte immigration des Irlandais chassés de leur pays par la famine ; farouchement hostiles aux Anglais, ils se sentent proches des Francophones, mais ils contribuent néanmoins à angliciser la province.
Malgré ses imperfections, la nouvelle constitution n'en est pas moins appuyée par Louis Hippolyte Lafontaine (1807-1864), un ancien fidèle de Papineau, brièvement emprisonné en 1838, que l'expérience a rendu modéré et qui, devant le fait accompli, s'efforce de tirer le meilleur parti possible des nouvelles institutions. Il est aidé en cela par les réformistes anglophones qui poursuivent le même but.
En 1843, une grève à Beauharnais tourne mal et les forces britanniques tuent 20 grévistes. En 1845 et 1846, des incendies ravagent un quartier de Québec. En 1847-1848, le typhus tue le tiers des immigrants irlandais retenus à Grosse-Île, station de quarantaine pour immigrants, dans l'estuaire du Saint-Laurent.
En 1848, Lafontaine et Robert Baldwin (1804-1858) obtiennent une modification démocratique de la constitution par l'introduction du principe de la responsabilité ministérielle devant l'Assemblée, ce qui ne change rien à la domination des Anglophones sur les Francophones; tout au plus l'alliance de Lafontaine avec les réformistes anglophones atténue-t-il la pression assimilationniste. La même année, Joseph Papineau, amnistié en 1845, est élu député de l'Assemblée du Canada. Il évolue vers le républicanisme, sous l'influence de ses séjours aux Etats-Unis et en France, et va devenir partisan de l'intégration de ce qui fut le Bas-Canada dans les Etats-Unis, à défaut de mieux, tout espoir paraissant désormais fermé aux Francophones dans le Canada uni.
 En 1849, des émeutiers anglophones incendient l'édifice parlementaire canadien de Montréal pour marquer leur opposition à la French Domination ; les instances gouvernementales déménagent à Toronto. La même année, James Bruce Lord Elgin (1811-1863), gouverneur général du Canada, fait approuver une amnistie générale et les exilés politiques de 1838 peuvent rentrer au pays ; les habitants du Bas-Canada ayant subi des pertes lors des événements de 1837-1838 sont indemnisés. Des émeutes paysannes éclatent contre les taxes scolaires et l'instruction obligatoire.
En 1849, des émeutiers anglophones incendient l'édifice parlementaire canadien de Montréal pour marquer leur opposition à la French Domination ; les instances gouvernementales déménagent à Toronto. La même année, James Bruce Lord Elgin (1811-1863), gouverneur général du Canada, fait approuver une amnistie générale et les exilés politiques de 1838 peuvent rentrer au pays ; les habitants du Bas-Canada ayant subi des pertes lors des événements de 1837-1838 sont indemnisés. Des émeutes paysannes éclatent contre les taxes scolaires et l'instruction obligatoire.
Les événements qui viennent d'être rapportés se sont déroulés dans un contexte économique défavorable. L'augmentation rapide de la population a entraîné un morcellement des propriétés. Les nouvelles terres à cultiver sont lointaines et peu productives. L'exploitation de la forêt offre des ressources insuffisantes pour remplacer les pertes de revenu causées par l'essoufflement de la traite des fourrures.
Entre 1842 et 1846, dans le cadre d'une politique de libre-échange, les produits canadiens cessent de bénéficier d'une protection tarifaire. Au plan économique, le Canada ne possède pas la taille critique pour espérer rivaliser avec son voisin du sud et son retard industriel ne fait que se creuser. Tous ces éléments favorisent l'exode rural et aussi l'émigration vers des Etats-Unis plus dynamiques (La Grande Hémorragie). En 1851, le gouvernement se transfère à Québec. En 1852, un nouvel incendie détruit plusieurs centaines de maisons à Montréal ; l'Université Laval est fondée à Québec qu'endeuille une épidémie de choléra. En 1854, le régime seigneurial est aboli ; les édifices parlementaires sont détruits par un incendie et le gouvernement retourne siéger à Toronto. En 1855, le gouverneur Edmund Walker Head humilie bêtement les Canadiens français en exaltant la supériorité de la race anglo-saxonne. En 1857, la reine Victoria désigne Ottawa comme capitale du Canada ; une crise économique éclate dans la colonie. En 1859, le gouvernement revient à Québec.
En 1861, plus de 85% des habitants du Bas-Canada habitent à la campagne et le quart de cette population est anglophone ; la population du Canada croit 5,5 fois plus vite que celle du futur Québec.
Les tensions entre les communautés, avivées par les difficultés économiques, montrent aux esprits les plus clairvoyants que la solution d’un Canada uni, dans lequel la spécificité francophone serait vouée à disparaître, est du domaine de l’utopie. Dès 1864, un projet de confédération des colonies britanniques d'Amérique est débattu au cours de plusieurs conférences, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et à Québec.
Le catholicisme élément principal d’un peuple à vocation agricole
George-Etienne Cartier, représentant du monde des affaires et du clergé se montre partisan de la réforme. Antoine-Aimé Dorion (1818-1891), homme politique libéral, la juge insuffisante et dangereuse ; il estime que ce n'est qu'une fédération déguisée et souhaiterait la restreindre aux deux provinces qui seront le Québec et l'Ontario. En 1865, le gouvernement canadien s'installe à Ottawa. En 1866, Alexander T. Galt (1817-1893), représentant du comté de Sherbrooke, fait adopter à Londres un texte garantissant les droits scolaires des minorités. De 1850 à 1870 s'élabore une idéologie nouvelle selon laquelle le catholicisme est l'élément principal d'un peuple canadien-français dont la vocation est agricole.
La naissance de la Confédération – La résurrection du Québec
En 1867, l'instabilité politique, les pressions intérieures et extérieures ainsi que les difficultés économiques, mettent un terme à l'expérience malheureuse du Canada uni. Le voisin américain, secoué par la Guerre de Sécession, se montre à nouveau menaçant, l'Angleterre ayant pris position en faveur des Sudistes. D'autre part, l'intégration des colonies anglaises dans l'espace économique nord-américain est devenue inévitable. L'Acte d'Union est dissout. Un Canada fédéral voit le jour sous la forme d'une Confédération canadienne, dominion de l'Empire britannique. Elle intègre d'abord l'ancien Haut-Canada, devenu l'Ontario, peuplé de Loyalistes, l'ancien Bas-Canada, qui redevient la province du Québec, peuplée de Canadiens français, ainsi que les provinces de Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, où résident encore des descendants des Acadiens. Les autres provinces constituant le Canada actuel s'y agrègeront ensuite au cours du temps.
 La conséquence majeure de cette réforme pour les Francophones, c'est évidemment la réapparition d'une province dans laquelle ils se trouvent à nouveau majoritaires. Cet Acte de l'Amérique du Nord britannique entérine l'échec de la politique d'assimilation ; il ne remet pas en cause les droits de la couronne puisqu'elle continue de contrôler étroitement la politique extérieure et l'armée du dominion, dont le pouvoir est limité aux finances, à la politique intérieure et au commerce. Mais elle octroie aux provinces un certain degré d'autonomie qui justifie l'existence à leur niveau d'une Assemblée législative et d'un gouvernement.
La conséquence majeure de cette réforme pour les Francophones, c'est évidemment la réapparition d'une province dans laquelle ils se trouvent à nouveau majoritaires. Cet Acte de l'Amérique du Nord britannique entérine l'échec de la politique d'assimilation ; il ne remet pas en cause les droits de la couronne puisqu'elle continue de contrôler étroitement la politique extérieure et l'armée du dominion, dont le pouvoir est limité aux finances, à la politique intérieure et au commerce. Mais elle octroie aux provinces un certain degré d'autonomie qui justifie l'existence à leur niveau d'une Assemblée législative et d'un gouvernement.
C'est pourquoi elle a été soutenue par George-Etienne Cartier (1814-1873) et par John A. MacDonald (1815-1891), le second étant pourtant partisan d'un Etat plus unitaire. C'est enfin une loi anglaise qui, en théorie, ne peut être modifiée que par le Parlement anglais. Ottawa devient la capitale de l'Etat fédéral. Les opposants les plus déterminés aux nouvelles institutions se recrutent parmi les Ecossais et les Irlandais ; l'un de ces derniers assassine à coups de revolver un député fédéraliste à Montréal. La population anglophone de la province du Québec amorce un lent déclin.
En 1868, le premier ministre du Québec Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890) crée un ministère de l'Instruction publique qui sera abolit en 1875 sous la pression du clergé qui redoute une évolution vers la laïcité, assimilée à la franc-maçonnerie propagatrice de l'idéologie révolutionnaire. D’emblée, le jeune gouvernement provincial se heurte à trois forces antagonistes : le pouvoir fédéral, l'opposition anglophone et le clergé catholique.
La révolte des métis
En 1869, le gouvernement canadien acquiert la Terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d'Hudson marquant par là sa volonté de soustraire l'ouest canadien aux appétits des Etats-Unis. Sans consulter la population, il prononce l'annexion de la province du Manitoba. Cet acte unilatéral entraîne la révolte des colons de l'endroit majoritairement francophones. Ils se dressent pour la défense de leur langue, de leur foi et pour leur autogestion. Le mouvement, qualifié de Rébellion de la Rivière Rouge, est dirigé par un Métis Louis Riel (1844-1885). Un gouvernement provisoire est créé ; il se heurte à une opposition anglophone qui méprise l'autorité des Métis. Des arrestations ont lieu et des condamnations à mort sont prononcées par le nouveau pouvoir métis, immédiatement suivies de grâces.
Cependant, l'un des conjurés, Thomas Scott, insulte ses gardiens qui exigent son exécution. Riel accède à leur demande et Scott est fusillé. Le gouvernement provisoire négocie cependant avec le gouvernement canadien ; on parvient à un accord et le Manitoba rejoint la Confédération canadienne. Un détachement militaire fédéral, est envoyé dans la colonie, sous les ordres de Garnet Wolseley (1833-1913), un militaire d’origine irlandaise chevronné, pour dissuader d'éventuelles tentatives américaines. Mais on dit aussi que les miliciens ontariens se proposent de lyncher Riel. Celui-ci se réfugie aux Etats-Unis.
 Il ne revient au Manitoba qu'en 1871, rassuré par l'élection de ses partisans. Il participe même à une mobilisation générale contre les Fenians yankees, un groupe d'Irlandais qui se livrent à des raids en territoire canadien. Salué cordialement par le représentant de la couronne, on n'en cherche pas moins à l'écarter, en lui offrant une somme d'argent, par l'intermédiaire d'un évêque. Il s'efface quelques temps puis revient dans l'arène politique, soutenu par George-Etienne Cartier qui milite pour son amnistie mais mourra malencontreusement en 1873, sans avoir obtenu gain de cause. Elu au parlement canadien, réélu, démis puis réélu à nouveau, Riel doit jouer à cache-cache avec ses ennemis qui menacent de l'assassiner et l'empêchent de siéger normalement, ce qui lui vaut une grande popularité parmi les Francophones.
Il ne revient au Manitoba qu'en 1871, rassuré par l'élection de ses partisans. Il participe même à une mobilisation générale contre les Fenians yankees, un groupe d'Irlandais qui se livrent à des raids en territoire canadien. Salué cordialement par le représentant de la couronne, on n'en cherche pas moins à l'écarter, en lui offrant une somme d'argent, par l'intermédiaire d'un évêque. Il s'efface quelques temps puis revient dans l'arène politique, soutenu par George-Etienne Cartier qui milite pour son amnistie mais mourra malencontreusement en 1873, sans avoir obtenu gain de cause. Elu au parlement canadien, réélu, démis puis réélu à nouveau, Riel doit jouer à cache-cache avec ses ennemis qui menacent de l'assassiner et l'empêchent de siéger normalement, ce qui lui vaut une grande popularité parmi les Francophones.
Le premier ministre de l'Ontario, Edward Blake, va jusqu'à proposer une récompense de 5000 dollars pour sa capture ! De nouveau exilé aux Etats-Unis, il apprend la condamnation à mort d’Ambroise-Dydime Lépine (1840-1923), son adjoint lors de la Rébellion de la Rivière rouge, en punition de l'exécution de Scott. L'opinion francophone s'indigne et réclame la clémence pour Riel et Lépine ; ce dernier finit par obtenir la commutation de sa peine. Mais Riel, dont la santé est déjà ébranlée, sombre dans une sorte de narcissisme religieux qui nécessite des soins, lesquels lui sont prodigués clandestinement au Québec. Après un bref répit en famille, en 1878, il part vers l'ouest et se mêle maladroitement de politique au Montana où il enseigne pendant quelques temps, dans une mission jésuite.
En 1871 un recensement révèle que les Francophones ne représentent plus que 30% de la population du Canada. En 1873, une crise économique ébranle la Confédération. Le gouvernement conservateur fédéral de John A. Macdonald met en œuvre une politique protectionniste en frappant les importations de droits de douane élevés, pour favoriser l'industrialisation du pays ; il prône l'extension des chemins de fer vers les villes secondaires et l'appel à l'immigration pour développer l'ouest du pays. Les résultats de cette politique s'avèrent profitables pour l'ensemble du Canada, et pour le Québec en particulier qui voit une bourgeoisie urbaine fortunée se créer. En 1876, un fermier de Thetford découvre une étrange pierre : l'amiante ; l'exploitation minière va commencer. En 1877, Wilfrid Laurier (1841-1919), ministre libéral fédéral originaire du Québec, dénonce les pressions du clergé sur les électeurs qui, l'année précédente, ont causé la défaite d'un député libéral dans un Québec toujours dominé par un catholicisme hostile au Parti libéral; le pape rappelle aux prêtres leur devoir de réserve en matière électorale et la hiérarchie du clergé québécois invite ce dernier à ne plus se mêler de politique en chaire. En 1880, un auteur francophone, Adolphe-Basile Routhier (1839-1920), écrit son poème « Ô Canada » qui deviendra l'hymne national canadien.
Après la Rébellion de la Rivière Rouge, beaucoup de Métis sont partis vers le Nord-Ouest. Mais les conditions d'existence y sont de plus en plus défavorables, notamment en raison de la disparition des bisons. Aussi, les Métis font-ils de nouveau appel à Riel. Ce dernier accepte, mais la tâche s'avère rude: il faut concilier les points de vue différents des Métis, francophones et anglophones, et déjouer les manœuvres dilatoires du gouvernement fédéral. Riel se sépare de plus en plus de la religion et du clergé. Une révolte armée finit par éclater. Elle se réfère à la Révolution française : les rebelles composent une Marseillaise rielliste. L'un des chefs, Gabriel Dumont (1837-1906), se montre partisan d'une longue lutte de guérilla propre à décourager l'adversaire ; Riel se prononce pour un affrontement général. Les rencontres ont lieu au Saskatchewan. L'armée des Métis remporte un succès à Fish Creek mais elle essuie une sévère défaite à la Bataille de Batoche, un mois plus tard, en mai 1885.
Riel, fait prisonnier, est envoyé à Winnipeg pour y être jugé. Mais, comme on redoute que le jury de la capitale du Manitoba ne lui soit par trop favorable, il est redirigé sur Régina (Saskatchewan) où on l'enferme, boulet aux pieds, dans une cellule de 3 m2, pendant deux mois, sans le secours du moindre avocat. Accusé de plusieurs actes de trahison, son cas est soumis à un jury dont une seule personne comprend un peu le français ; la défense est assurée par de jeunes avocats du Québec et par un avocat anglophone récemment établi à Régina. La condamnation ne fait aucun doute. L'accusé expose longuement les droits des Métis. Le jury, qui n'a évidemment rien compris à cette intervention, et qui pense même qu'on juge le prévenu pour le meurtre de Scott, le déclare coupable tout en réclamant la clémence. Le juge passe outre à la requête du jury et Riel est pendu, après s'être réconcilié avec l'église catholique, le 16 novembre 1885.
Cet assassinat juridique monte un peu plus les Francophones contre les Anglophones. Dans la mémoire des premiers, dont certains sont sangs mêlés, Riel, martyr de la cause métisse, est l'un des leurs. Cette affaire est symbolique des rapports psychologiques qui se sont développés entre les deux peuples fondateurs du Canada, d'un côté des Francophones vaincus et qui se sentent humiliés, de l'autre côté des Anglophones, sans doute ethniquement plus purs parce que leur émigration s'est souvent faite par famille, vainqueurs et imbus de leur supériorité raciale et économique. Cette présentation schématique, à peine forcée, subsistera jusque vers la fin du vingtième siècle. En 1885, des libéraux et des conservateurs du Québec, choqués par le dénouement de l'affaire Riel, rejoignent le Parti national, existant depuis 1871, dont le leader, Honoré Mercier (1840-1894), devient premier ministre provincial en 1887.
 Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l'économie du Québec s'industrialise, à partir de l'exploitation des ressources naturelles (hydroélectricité, pâtes à papier, métallurgie de l'aluminium, moulins à laine pour le tissage, amiante...). Vers 1880, apparaissent des organisations syndicales inspirées des Etats-Unis, les Chevaliers du Travail que Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau (1820-1898) fera interdire par le Vatican en 1885 sous l'accusation de franc-maçonnerie, ce qui n'empêchera pas à d'autres organisations ouvrières de se constituer pour améliorer les conditions d'existence des travailleurs. La population rurale ne représente plus que 70% des habitants du Québec. L'électricité et le téléphone font leur apparition. En 1897, la première automobile à essence du Canada, la fossmobile, est fabriquée à Sherbrooke, dans les Cantons de l'Est du Québec, par George Foote Foss (1876-1968).
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l'économie du Québec s'industrialise, à partir de l'exploitation des ressources naturelles (hydroélectricité, pâtes à papier, métallurgie de l'aluminium, moulins à laine pour le tissage, amiante...). Vers 1880, apparaissent des organisations syndicales inspirées des Etats-Unis, les Chevaliers du Travail que Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau (1820-1898) fera interdire par le Vatican en 1885 sous l'accusation de franc-maçonnerie, ce qui n'empêchera pas à d'autres organisations ouvrières de se constituer pour améliorer les conditions d'existence des travailleurs. La population rurale ne représente plus que 70% des habitants du Québec. L'électricité et le téléphone font leur apparition. En 1897, la première automobile à essence du Canada, la fossmobile, est fabriquée à Sherbrooke, dans les Cantons de l'Est du Québec, par George Foote Foss (1876-1968).
La production québécoise est surtout destinée à l'exportation. Comme les capitaux locaux font défaut, les nouvelles entreprises sont financées d'abord par des Anglais ensuite par des Américains. L'économie québécoise échappe ainsi en grande partie aux Francophones. L'exode vers les villes se poursuit, mais l'émigration vers les Etats-Unis devient résiduelle : les Québécois trouvent des emplois sur place. Le syndicalisme se développe pour la défense des ouvriers spécialisés, seuls à bénéficier d'un emploi stable. L'immigration est encouragée par le gouvernement canadien pour occuper les territoires de l'ouest et les soustraire ainsi à la convoitise des Etats-Unis. Un chemin de fer, le Canadian-Pacific, rapproche l'Atlantique du Pacifique.
Le peuplement des nouvelles provinces de l'ouest relativise l'importance du Québec au moment où sa population francophone voit arriver des Anglais, mais aussi des Italiens, des Grecs et des ressortissants des pays de l'est européen (Polonais, Ukrainiens). Je n'oublierai pas aussi le faible apport des Alsaciens-Lorrains qui refusent l'annexion de leur région à l'Allemagne, à l'issue de la guerre de 1870, puisque j'ai connu un de leurs descendants. La plupart de ces nouveaux-venus rêvent de s'intégrer dans une Amérique du Nord anglo-saxonne. Ils vont donc modifier sensiblement l'équilibre démographique entre les Anglophones et les Francophones suscitant parfois chez ces derniers un sentiment de rejet teinté de xénophobie.
En 1890, la suppression du français dans les écoles du Manitoba, mesure précédée puis imitée dans d'autres provinces, suscite au Québec une poussée de nationalisme. En 1891, les partis fédéraux profitent d'un scandale financier pour faire tomber Honoré Mercier qu’ils estiment capable de mener le Québec à l'indépendance. En 1896, après une longue lutte, l'Ontario obtient la reconnaissance par Londres de la souveraineté des provinces dans leurs sphères de juridiction. En 1900, pour faire pièce au monde financier Anglo-saxon, qui refuse ses prêts aux Francophones, Alphonse Desjardins (1854-1920) fonde un mouvement de coopératives d'épargne et de crédit qui est promis à un bel avenir et porte encore son nom.
Un mot sur les conditions sanitaires de la province à cette époque : en 1885, une épidémie de variole tue près de 3000 personnes à Montréal ; la mortalité infantile est très élevée dans la province (30% à Montréal !) à cause de la diarrhée, de la tuberculose, de la diphtérie de la scarlatine et de la typhoïde. Au début du 20ème siècle, la population du Québec dépasse 1,6 millions d'habitants, mais les autres provinces du Canada en comptent plus de 3,7 millions.
La résurgence du nationalisme québécois
Le nationalisme canadien français se développe alors autour d’Henri Bourassa (1868-1952), petit-fils de Louis-Joseph Papineau, journaliste et homme politique catholique, qui s'est opposé, en 1899, à l'implication de la confédération dans la Guerre des Boers. A cette occasion, alors qu'il prononce un discours en français, il est interpellé par un député anglophone qui lui crie : « Speak white ! », ce qui est significatif du mépris dans lequel il tient les Francophones assimilés à des Indiens. Il est à noter que le premier ministre fédéral, qui est pour la première fois francophone, Wilfrid Laurier, refuse la participation du Canada au conflit mais, pour ménager les susceptibilités anglaises, il accepte de défrayer le transport des volontaires.
En 1910, Henri Bourassa fonde le journal Le Devoir. Ce quotidien militera pour un projet d'émancipation du Canada de la tutelle britannique et défendra les droits des Canadiens français. Bourassa plaide d'abord pour l'accès de la Confédération à la pleine souveraineté. Il pense que l'harmonie se rétablira entre Francophones et Anglophones dans un Canada indépendant. Mais cette vision idéale des rapports entre les deux peuples fondateurs est remise en cause par un certain nombre d'incidents, notamment lorsque des lois provinciales restreignent l'usage du français.
 Dès 1901, les ruraux ne représentent plus que 60% de la population du Québec. En 1912, le Québec annexe le Nouveau-Québec au nord de son territoire.
Dès 1901, les ruraux ne représentent plus que 60% de la population du Québec. En 1912, le Québec annexe le Nouveau-Québec au nord de son territoire.
La Première Guerre mondiale
En 1914, la Grande-Bretagne, qui dirige la politique extérieure du Canada, oblige ce dernier à participer à la Première Guerre mondiale (60000 morts canadiens). L'opposition entre Canadiens anglais, fidèles à la couronne britannique, et Canadiens français, plus que réservés, devient alors manifeste. En 1917 un impôt sur le revenu « provisoire » est instauré au Canada pour financer l'effort de guerre ; il ne disparaîtra jamais. En 1918, la conscription entraîne une émeute à Québec; l'armée mitraille la foule ; on relève quatre morts, tous tués par balles explosives, et de nombreux blessés ; plus de deux cents personnes sont arrêtées dans les jours qui suivent ; l'Habeas corpus est suspendu. L'opinion de Bourassa évolue du nationalisme canadien au nationalisme québécois.
Au lendemain de la Grande Guerre, le Royaume-Uni n'a plus la capacité de financer l'expansion économique du Canada qui tombe de plus en plus sous l'emprise des capitaux américains. Tandis qu'un service d'autobus entre en service à Montréal, en 1919, une récession frappe la province et l'émigration québécoise vers les Etats-Unis reprend massivement, jusqu'en 1926. Le gouvernement fédéral assouplit la politique d'immigration en raison de l'importance du déficit migratoire.
Deux courants idéologiques s'affrontent alors au Québec : le libéralisme de Louis-Alexandre Taschereau (1867-1952), premier ministre provincial de 1920 à 1936, favorable au progrès et au développement industriel, et le nationalisme clérical incarné par l'abbé Lionel Groulx (1878-1967), écrivain et historien nationaliste, qui défend les valeurs traditionnelles familiales et agricoles et présente la défaite de 1760 comme une catastrophe pour les Canadiens français.
En 1922, la création de la station CKAC introduit la radiodiffusion au Québec.
A 1927, Londres fixe la frontière entre le Québec et la Labrador qui est attribué à Terre-Neuve. Le Québec ne reconnaît pas cette frontière avec un territoire riche en ressources minières dont il estime avoir été dépouillé.
La Grande Dépression
Après un regain de prospérité dans la seconde partie des années 1920, la grande dépression de 1929 frappe à nouveau la province. Le taux de chômage passe de 3 à 25% et les salaires chutent de 40%. La situation devient d'autant plus difficile que les Etats-Unis n'offrent plus de débouché au surplus de main-d’œuvre québécoise.
Le 22 juin 1930, deux jours avant la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste, est inaugurée à Montréal, entre le Palais de Justice et l'Hôtel de Ville de Montréal, une statue à la mémoire de l'officier de marine français Jean Vauquelin qui s'est illustré en tentant de reprendre aux Anglais la ville de Québec. La construction de ce monument a été parrainée par la Société Saint-Jean-Baptiste. Le choix de son emplacement n'est pas innocent : la statue se dresse face à la colonne de Nelson, comme pour défier le vainqueur de Trafalgar. Au symbole de l'impérieuse domination britannique, l'élite québécoise oppose celui de la valeur française malheureuse. Dans le même ordre d'idée, une statue de Jeanne d'Arc s'élève à Québec, non loin de l'endroit où Wolfe à triomphé de Montcalm.
En 1931, dans le contexte de la grande dépression, le statut de Westminster, qui institue le Commonwealth, confère la pleine souveraineté au Canada, sans soulever l'enthousiasme. L'Ontario et le Québec, qui craignent un pouvoir fédéral trop puissant, ne voient pas ce changement sans appréhension. La transition s'effectue très lentement : la citoyenneté canadienne n'est effective qu'en 1947 ; le drapeau qu'en 1965, et encore nombre de Canadiens anglais continuent-ils de déployer devant leur maison l'Union Jack, à côté du drapeau à feuille d'érable qui a remplacé le Red Ensign frappé de l’Union-Jack ; l'hymne national, écrit par un francophone, en 1980.
En 1935, la crise pousse le gouvernement provincial à prôner le retour à la terre. A cette époque la population rurale ne représente plus que 40% de la population de la province et, au cours du siècle qui vient de s'écouler, près d'un million de Québécois sont partis chercher du travail aux Etats-Unis. De 1932 à 1937, Grosse-Île, toujours station de quarantaine pour immigrants, est frappée par des épidémies de choléra et de typhus. La mortalité infantile a beaucoup diminué au Québec mais elle reste élevée (10%) quoique dans la norme des pays développés.
L’Union nationale, un conservatisme nationaliste
Des dissidents du Parti libéral de Taschereau créent l'Action libérale nationale qui s'allie au Parti conservateur pour donner naissance à l'Union nationale dont le chef, Maurice Duplessis (1890-1959), exerce le pouvoir de 1936 à 1939. Ce leader conservateur doit sa fortune politique à sa dénonciation du favoritisme (patronage en québécois) dont fait preuve le Parti libéral, ce qui ne l'empêche pas ultérieurement d'être soupçonné lui aussi de tomber dans ce travers. Il se singularise d'emblée, dès 1937, par la « Loi du Cadenas », jugée anticonstitutionnelle, qui musèle la liberté d'expression, pour lutter contre le communisme et le syndicalisme, favorisant ainsi objectivement le monde des affaires anglo-saxon, au détriment du monde du travail francophone, paradoxe curieux pour un nationaliste.
En 1939, les armoiries et la devise du Québec : « Je me souviens » sont adoptées ; le Parti libéral revient au pouvoir. Le premier ministre, Adélard Godbout (1892-1956), reconnaît aux travailleurs le droit syndical. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Québécois évoluent vers le nationalisme, d'une part parce qu'ils y voient le seul moyen d'échapper à l'assimilation des Francophones à l'œuvre dans les autres provinces et, d'autre part, parce que la crise leur démontre que le gouvernement provincial n'est pas doté de pouvoirs suffisants pour les protéger contre les aléas économiques. En 1940, Godbout, accorde aux femmes le droit de vote. Il applique une politique qui annonce, sous certains aspects, la révolution tranquille. Mais, la guerre va lui être fatale en ravivant les tensions autour de la conscription.
La Seconde Guerre mondiale et la querelle autour du service militaire
La guerre donne un coup de fouet salutaire à l'économie du Québec mais elle fait ressurgir à nouveau le clivage entre Canadiens anglais, favorables à la participation au conflit, et Canadiens français peu disposés à aller se faire tuer en Europe pour le roi d'Angleterre. Le premier ministre fédéral, Mackenzie King (1874-1950), promet aux Québécois qu'ils ne seront pas enrôlés contre leur gré. La jeunesse montre à sa façon le peu de confiance qu'elle accorde aux promesses du premier ministre fédéral : une épidémie de mariages se répand à travers le Québec ; les prêtres en bénissent plusieurs par jour, les jeunes gens espèrent qu'on n'osera pas les arracher à leur foyer.
Pour lutter contre ce manque évident d'enthousiasme pour les travaux guerriers, la propagande britannique propage la peur, afin de susciter des vocations militaires ; on appose des affiches qui incitent la population à se protéger contre les bombardements allemands, alors qu'aucun avion n'est encore capable d'effectuer le trajet Europe-Amérique dans les deux sens, même si des sous-marins nazis rôdent près des côtes canadiennes ; on parle même d'appliquer la politique de la terre brûlée en cas d'invasion ! Le député maire de Montréal, Camille Houde (1889-1958), fermement opposé au service militaire, est déporté pendant quatre ans sans jugement dans un camp de concentration.
En 1941 l'assurance chômage est instituée.
En 1942, le gouvernement fédéral demande aux Canadiens de le relever par référendum de sa promesse faite aux Québécois de ne pas les forcer à participer au conflit. Les résultats de la consultation sont éloquents : 71% des Québécois répondent négativement (85% des Francophones), mais 80% des citoyens des autres provinces apportent leur soutien à la proposition gouvernementale qui est ainsi adoptée. Les Québécois vont donc fournir malgré eux une part non négligeable de la chair à canon de l'Empire britannique. Combien resteront sur les plages de France, à Dieppe (2753 morts canadiens) et en Normandie ? La preuve est une fois de plus administrée que les Canadiens français ne peuvent plus faire entendre leur voix dans l'ensemble fédéral et le nationalisme québécois en sort renforcé. Henri Bourassa, bien qu'à l'écart de la vie publique depuis des années, appuie le Bloc populaire canadien, un parti politique québécois de centre-gauche, dans son opposition à la conscription.
En 1943, le Québec réclame la restitution du Labrador.
La même année, la Sicile est conquise par les alliés (2344 morts canadiens) ; entre le 18 et le 24 août, la ville de Québec accueille Churchill et Roosevelt venus s'entretenir de la chute de l'Italie fasciste et de la suite à donner à la guerre, au Château Frontenac, avec Mackenzie King.
En 1944, un régime d'aide aux familles est élaboré mais le libéral Godbout est battu par le conservateur Duplessis qui détient dans son jeu l'atout maître nationaliste.
L’époque de la Grande Noirceur
 Après la fin du conflit, le Québec connaît une période de prospérité économique. Les revenus progressent, les conditions de travail s'améliorent et les Québécois commencent à accéder au rêve américain. Mais en même temps, la période qui va de 1945 à 1960 est qualifiée de Grande Noirceur. Elle est dominée par la personnalité de Maurice Duplessis qui restera premier ministre jusqu'à sa mort. Ultraconservateur au plan politique comme au plan économique, favorable au grand capitalisme américain et aux milieux d'affaires, opposé à l'interventionnisme étatique, imprégné de morale religieuse étroitement traditionaliste, il impose au Québec un régime qui s'apparente à celui de Salazar au Portugal. Il maintient fermement l'enseignement et les soins de santé aux mains du clergé. Il fait peser sur la société québécoise une chape de plomb. Mais sa politique n'est pas exempte de contradictions puisqu'il crée aussi un Ministère de la Santé et du Bien Etre social.
Après la fin du conflit, le Québec connaît une période de prospérité économique. Les revenus progressent, les conditions de travail s'améliorent et les Québécois commencent à accéder au rêve américain. Mais en même temps, la période qui va de 1945 à 1960 est qualifiée de Grande Noirceur. Elle est dominée par la personnalité de Maurice Duplessis qui restera premier ministre jusqu'à sa mort. Ultraconservateur au plan politique comme au plan économique, favorable au grand capitalisme américain et aux milieux d'affaires, opposé à l'interventionnisme étatique, imprégné de morale religieuse étroitement traditionaliste, il impose au Québec un régime qui s'apparente à celui de Salazar au Portugal. Il maintient fermement l'enseignement et les soins de santé aux mains du clergé. Il fait peser sur la société québécoise une chape de plomb. Mais sa politique n'est pas exempte de contradictions puisqu'il crée aussi un Ministère de la Santé et du Bien Etre social.
En 1948, des artistes s'élèvent contre l'immobilisme de la société et défendent l'idée d'une culture québécoise spécifique dans un manifeste qui fait date, « Refus global », même si sa diffusion reste limitée dans un premier temps. Les lettres et les arts québécois se sont étroitement inspirés du modèle français dans le passé, mais ce n'est maintenant plus le cas : des œuvres originales émergent, la notoriété internationale des artistes québécois en portera bientôt le témoignage. Paul-Emile Borduas (1905-1960), un des rédacteurs du manifeste, est exclu de l'école où il enseignait ; il s'exile en France.
Nationaliste, Duplessis conteste les ingérences dans la vie provinciale d'un pouvoir fédéral qui concentre entre ses mains l'essentiel des ressources fiscales (83% en 1945). C'est sous son régime, en 1948, que le drapeau bleu à croix blanche fleurdelisé devient l'emblème du Québec et remplace le pavillon anglais au fronton des bâtiments publics ; il a été choisi de préférence au drapeau tricolore des patriotes, jugé probablement provocateur et trop révolutionnaire.
Dans cette atmosphère conservatrice et cléricale, à contre courant de l'évolution du reste du monde, malgré des progrès économiques indéniables, le Québec, qui accumule les retards en matière d'éducation et d'évolution des mœurs, reste néanmoins un lieu attractif d'immigration. Des Français qui fuient une Europe en ruines, toujours menacée par de nouveaux conflits, et aussi, plus tard des orphelins de la décolonisation, viennent y tenter leur chance. Ils n'y sont pas toujours bien accueillis. On reproche a ces ressortissants d'un pays jugé bien petit, depuis la défaite de 1940, leur langage précieux, leur inconcevable fatuité et surtout le fait qu'ils enlèvent des emplois aux enfants d'une contrée où le chômage est structurellement élevé pendant la mauvaise saison. Certains talents sont cependant recherchés (les mécaniciens automobile, par exemple). De plus, les Québécois gardent toujours une dent contre la France qui les a abandonnés deux siècles plus tôt.
En 1949, une grève dans les mines d'amiante se prolonge pendant cent trente huit jours ; elle aura un impact important sur les conditions de travail dans l'industrie minière. En 1952, la télévision fait son apparition.
En 1954, Duplessis crée un impôt provincial sur le revenu.
En 1955, une émeute éclate au Forum de Montréal ; le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Sutherland Campbell (1905-1984), qui a suspendu un joueur prestigieux, Maurice Richard (1921-2000), idole du public québécois, est violemment pris à partie par la foule en colère. Ce mouvement d'humeur, assorti de jet de projectiles divers, est significatif de la tension qui règne entre les deux communautés : Richard est un québécois qui a réussi et qui tient la dragée haute aux Anglophones dont Campbell est le représentant symbolique. Par association, un ingrédient alimentaire fera par la suite les frais de la vindicte populaire : la sauce Campbell verra ses ventes chuter !
La révolution tranquille
En 1960, le parti libéral gagne les élections et son chef, Jean Lesage (1912-1980), devient premier ministre du Québec. Il inaugure une ère de grands changements. Sous l'influence des séries télévisées venues des Etats-Unis, la société québécoise est en train d'accentuer son américanisation. Le développement économique, qui s'inscrit dans le prolongement des tendances antérieures, est propice à la générosité. Une relative abondance des ressources fiscales permet d'envisager des réformes sociales, notamment dans le domaine du bien être social et de l'assistance maladie. Mais les entreprises restent largement aux mains d'investisseurs étrangers. En 1961, seulement 7% d'entre elles sont sous le contrôle de Québécois. C'est dans ce contexte que s'inscrit la révolution tranquille, en contrepoint à la période d'immobilité de Duplessis.
 Sous le signe du changement, d'ambitieuses réformes sont lancées en matière de politique sociale, d'éducation, de santé et de développement économique. Pour réduire l'emprise extérieure sur l'économie, le gouvernement provincial élabore un vaste programme de nationalisations sous l'égide du slogan « Maîtres chez nous » visant à réduire la suprématie des milieux d'affaires anglo-saxons et protestants. Des institutions financières étatiques sont créées, comme la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec et la Société Générale de Financement. Mais la mesure emblématique de l'époque est l'acquisition par l'Hydro-Québec, fondée en 1944, de tous les distributeurs d'électricité de la province, à la suite d'une élection anticipée, jouée sur cette question, par les libéraux qui sont reconduits au pouvoir. C’est aussi à cette époque, entre 1962 et 1966, que les premières lignes du métro de Montréal sont aménagées.
Sous le signe du changement, d'ambitieuses réformes sont lancées en matière de politique sociale, d'éducation, de santé et de développement économique. Pour réduire l'emprise extérieure sur l'économie, le gouvernement provincial élabore un vaste programme de nationalisations sous l'égide du slogan « Maîtres chez nous » visant à réduire la suprématie des milieux d'affaires anglo-saxons et protestants. Des institutions financières étatiques sont créées, comme la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec et la Société Générale de Financement. Mais la mesure emblématique de l'époque est l'acquisition par l'Hydro-Québec, fondée en 1944, de tous les distributeurs d'électricité de la province, à la suite d'une élection anticipée, jouée sur cette question, par les libéraux qui sont reconduits au pouvoir. C’est aussi à cette époque, entre 1962 et 1966, que les premières lignes du métro de Montréal sont aménagées.
Un effort particulier est consenti en faveur de l'éducation qui se laïcise ; un ministère de l'Education est créé, des commissions scolaires voient le jour, l'enseignement secondaire est développé par l'institution des CEGEP ; pour accompagner cette rénovation, de nombreux enseignants français viennent effectuer au Québec l'équivalent de leur service militaire, dans le cadre de la coopération. L'existence d'une culture québécoise spécifique est à nouveau revendiquée et on exige qu'elle ait enfin toute la place qui devrait lui revenir, quoi qu'en pense le monde anglo-saxon.
Les valeurs traditionnelles sont remises en question, des interdits sont levés et la religion est en recul dans une population qui lui était jusqu'à présent étroitement soumise. Cette évolution entraîne une forte baisse de la natalité : les familles nombreuses, qui étaient jadis la règle, deviennent l'exception. En 1964, les femmes obtiennent la capacité de signer des actes juridiques sans l'autorisation de leur mari.
En résumé, on pourrait dire que la révolution tranquille consiste en l'avènement d'un Etat-Providence moderne et laïc, enfin émancipé des influences religieuses. L'éducation et la charité chrétienne cèdent la place à l'instruction laïque et aux institutions sociales. Cette transformation révolutionnaire est indéniablement la conséquence des pressions accumulées depuis longtemps du fait de l'affaiblissement du monde rural au profit du monde urbain, pressions qui se sont accentuées du temps de la Grande Noirceur. Ajoutons qu'elle s'effectue dans un contexte extérieur caractérisé par d'importants changements sociétaux, en Europe comme en Amérique. En matière de politique extérieure, elle débouche sur une utilisation plus intense des marges de manœuvre qu'offre aux provinces la Constitution canadienne pour nouer des relations avec des Etats étrangers par le biais de délégations générales.
Cette transformation de la société québécoise suscite l'incompréhension du gouvernement fédéral. En 1963, le premier ministre fédéral, Lester B. Pearson (1897-1972), pose la question : « Que veut le Québec ? » et, pour tenter d'y répondre, il crée une Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Les travaux de cette Commission aboutissent à un échec qui ne fait que mettre en lumière le fossé qui sépare les deux communautés.
La montée du mouvement indépendantiste : le concept de Nègres blancs d’Amérique
Les Anglophones se montrent hostiles à toute concession accordée aux Francophones qui précèderait à leurs yeux l'éclatement de la Confédération et qui mettrait en question leur prédominance économique. Du côté des Francophones, dans le contexte international de la décolonisation, le souverainisme québécois évolue vers la revendication de l'indépendance. Des partis politiques sécessionnistes se constituent, dès 1960 : Le Ralliement national (RN) et le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN).
Au début des années 1960, une fraction des indépendantistes se radicalise et fonde le Front de Libération du Québec (FLQ) qui considère que le Québec est un pays colonisé par les Anglais depuis la conquête et que seule la lutte armée permettra sa libération, d'où l'organisation d'une Armée de Libération du Québec (ALQ) ; des attentats sont commis et l'idéologue du mouvement, Pierre Vallières (1938-1998), dans une autobiographie qu'il rédige en prison, affirme que les Québécois sont les Nègres blancs d'Amérique. Cette assimilation du Québec à un pays à décoloniser trouve en partie son origine dans le déclassement social d’une grande partie des Francophones et aussi dans le fait que la province est encore en retard en matière d’industrialisation, malgré les changements intervenus, et que son économie est encore trop largement tournée vers l’exportation de matières premières transformées ailleurs.
Jusqu'à présent, si l'ont met à part les tentatives du 19ème siècle plus ou moins inspirées par la Révolution française, le nationalisme québécois a plutôt été l'apanage du conservatisme ; maintenant ce sont les partisans du mouvement qui l'incarnent ; l'esprit de conquête l'emporte sur l'esprit de résistance. La figure du patriote de 1838 émerge à nouveau des brumes de l'histoire et son drapeau tricolore sort des poches des plus déterminés.
En 1964, à l'occasion d'une visite de la reine Elisabeth II, une foule inoffensive est brutalement dispersée à coups de matraques. En 1965, sous la pression du Québec, le gouvernement fédéral autorise le retrait d'une province d'un programme fédéral avec compensation. Aux élections de 1966, bien que le Parti libéral soit vainqueur en voix, c'est l'Union nationale qui  remporte le plus grand nombre de siège et Daniel Johnson (1915-1968) prend la tête du gouvernement. Mais l'élan est donné et les réformes vont se poursuivre. En 1967, le général de Gaulle reçoit, de Québec à Montréal, sur le Chemin du Roy, un accueil triomphal.
remporte le plus grand nombre de siège et Daniel Johnson (1915-1968) prend la tête du gouvernement. Mais l'élan est donné et les réformes vont se poursuivre. En 1967, le général de Gaulle reçoit, de Québec à Montréal, sur le Chemin du Roy, un accueil triomphal.
Au balcon de l'Hôtel de Ville de la seconde ville francophone du monde, l'enthousiasme de la foule lui rappelant la libération de Paris, il ne peut retenir un retentissant « Vive le Québec libre » qui est aussitôt interprété, par les deux camps, d'une manière qui dépasse probablement sa pensée. Pour les fédéralistes, c'est une insupportable ingérence dans les affaires intérieures canadiennes ; pour les séparatistes, c'est un appel à l'indépendance lancé par le président de la vieille mère-patrie et cet appel est perçu comme un encouragement à intensifier la lutte.
Un ministre libéral, René Lévesque (1922-1987), qui estime que le Québec n'a aucun avenir dans le cadre fédéral, quitte son parti pour fonder le Mouvement Souveraineté-Association. Cet homme politique charismatique, l'un des artisans des réformes, jouit d'une énorme popularité et René la Cigoune (la cigarette), comme on le surnomme familièrement, grand fumeur devant l'éternel, n'a pas fini de faire parler de lui. La même année, d'avril à octobre, se tient l'Exposition universelle de Montréal ; elle accueille plus de 50 millions de visiteurs (j'y étais). En 1968, Radio-Québec et l'Université du Québec sont créées. La même année, 290 personnes sont arrêtées à Montréal pendant le défilé de la Saint-Jean Baptiste ; les partis souverainistes fusionnent pour donner naissance au Parti québécois sous l'autorité de René Lévesque.
En 1969, pour tenter de retenir le Québec dans la Confédération, Pierre Eliott Trudeau (1919-2000), premier ministre du Canada, fait adopter une loi qui rend le bilinguisme officiel dans les institutions fédérales ; le recrutement de fonctionnaires francophones s'en trouve facilité. La même année, le projet de loi 63, qui met à égalité le français et l'anglais au Québec, suscite de nombreuses manifestations hostiles et la création d'un Front commun du Québec français qui réclame l'usage unique du français dans la province, à tous les niveaux. Après de violents incidents, les manifestations sont interdites par le maire de Montréal, Jean Drapeau (1916-1999).
A l'issue de la révolution tranquille, force est de constater que les Québécois ne sont plus des Français vivants en Amérique du Nord, mais bel est bien un peuple américain nouveau, qui s'est forgé une identité nationale spécifique, notamment à partir de la préservation sourcilleuse de sa langue maternelle, mais pas seulement. La revendication culturelle québécoise s'adresse aussi bien à la France qu'à l'Angleterre.
La loi sur les mesures de guerre
En 1970, la montée du nationalisme dans la jeunesse est manifeste. Des personnes fortunées s'affolent et transfèrent des fonds importants en Ontario. Le Parti québécois obtient 23% des voix (contre 8% aux partis indépendantistes 4 ans plus tôt). Le Parti libéral de Robert Bourassa (1933-1996) retrouve le pouvoir, après avoir battu l'Union nationale, qui dirigeait la province depuis 1966. Bourassa est fédéraliste, mais il admet que la Confédération doit être réformée et milite pour que les droits des Québécois soient respectés. Il fait d'ailleurs adopter une loi (la loi 22), en 1974, qui déclare le français langue officielle du Québec, tout en reconnaissant deux langues nationales : le français et l'anglais ; cette mesure ne satisfait ni les Anglophones, qui se sentent lésés, ni les Francophones, qui l'estiment insuffisante.
Il institue également l'assurance-maladie (1970), malgré l'opposition d'une partie des médecins, les allocations familiales (1973), l'aide juridique (1973) et la Charte des droits et libertés de la personne (1975). Il s'intéresse aux femmes qui sont autorisées à faire partie des jurés, après que 7 d'entre elles aient chahuté une audience ; il crée un Conseil du statut de la femme. Par ailleurs, Bourassa lance le projet hydroélectrique de la Baie James, malgré l'opposition des indiens Cris soutenus par les défenseurs de l'environnement. Il travaille aussi efficacement, avec le maire de Montréal, Jean Drapeau, à la préparation des Jeux Olympiques d'été, qui se tiendront en 1976 dans la métropole canadienne.
Mais l'événement majeur de son premier mandat est la Loi sur les mesures de guerre. Peu après son élection, à l'automne 1970, le FLQ passe à l'attaque en enlevant deux personnes : un diplomate britannique, James Cross (né en 1921), et surtout le ministre du Travail du gouvernement provincial, Pierre Laporte (1921-1970) qui est retrouvé assassiné. Ces enlèvements soulèvent une grande émotion dans le pays et creusent encore un peu plus le fossé qui s'élargit entre les communautés. Je me souviens avoir vu à cette époque, dans un village anglophone, un écriteau sur lequel on lisait: « Maison à vendre mais pas à des Français » ! Le gouvernement provincial sollicite l'intervention du gouvernement fédéral qui déploie des mesures militaires disproportionnées.
L'armée canadienne prend le contrôle de la province ; quatre cent cinquante sept personnalités souverainistes sont arrêtées, dont la chanteuse Pauline Julien (1928-1998), par la gendarmerie royale, dans des conditions contestables. Cette effervescence se calme assez rapidement, après le départ vers Cuba des preneurs d'otages qui ont libéré Cross. Mais Bourassa se heurte à l'intransigeance du premier ministre du Canada, Pierre Eliott Trudeau (1919-2000), pourtant lui aussi libéral et d'origine québécoise, mais parfaitement bilingue et farouche partisan de l'unité du Canada. La situation constitutionnelle est gelée, ce qui ne peut que favoriser les indépendantistes. Aussi, aux élections suivantes, en 1976, le Parti québécois accède-t-il au pouvoir ; René Lévesque devient premier ministre du Québec.
Le Parti québécois au pouvoir
Le Parti québécois a promis de ne pas proclamer l'indépendance sans consulter au préalable la population par référendum. En dehors de cette précaution, qui a sans doute levé bien des réticences, il proposait un programme social-démocrate assorti de la protection des droits des Francophones qui sera largement appliqué. La mesure phare de ce premier mandat est la loi sur la protection de la langue française (Loi 101), votée en 1977, qui a valeur quasiment constitutionnelle et qui renforce les dispositions de la Loi 22 de 1974. Cette loi fera l'objet de nombreuses discussions et de recours devant les juridictions canadiennes qui amèneront un futur gouvernement provincial libéral à l'amender. Décriée par les Anglophones, elle met pourtant fin à une anomalie : dans les faits, le Québec était la seule province à devoir pratiquer le bilinguisme.
Cette situation s'avérait facteur d'injustice, au détriment des Francophones, dans la mesure où les entreprises, majoritairement dirigées par des Anglo-saxons, privilégiaient naturellement, au moment de l'embauche, les candidats parlant le mieux l'anglais. La loi offre ainsi des débouchés aux Francophones, dont le taux de chômage est plus élevé que celui des Anglophones, surtout depuis les crises pétrolières du milieu des années 1970, car les entreprises ont désormais intérêt à rédiger leurs documents en bon français. En réalité, depuis déjà plusieurs années, le mouvement était amorcé par les consommateurs québécois qui avaient tendance à boycotter les produits trop ouvertement anglo-saxons.
Beaucoup de Francophones se sentent désormais d'abord Québécois et ils reprennent les étrangers qui, peu au courant des subtilités de la politique locale, les traitent de Canadiens. Leur capitale nationale, c'est Québec, Ottawa n'est plus que la capitale fédérale.
Entre 1976 et aujourd'hui, le Parti québécois et le Parti libéral se partagent le pouvoir. L'union nationale conservatrice a été laminée avant de disparaître. Mais, au début des années 1990, un nouveau parti souverainiste entre en scène : l'Action démocratique de Mario Dumont.
A certaines périodes, le Parti québécois, fort de l'importance électorale du Québec, qui vote massivement pour les candidats francophones, représente l'opposition officielle au parlement d'Ottawa ; cette situation paradoxale donne l'occasion aux indépendantistes de dialoguer avec leurs opposants au sein même des instances canadiennes et sans doute de faire tomber bien des préventions.
Le rapatriement de la Constitution et la querelle institutionnelle
En 1981, Pierre Eliott Trudeau envisage de rapatrier la Constitution canadienne qui relève toujours du Parlement britannique. Les discussions entre les provinces font apparaître de sérieuses divergences. Trudeau règle le problème, en l'absence de René Lévesque, tenu volontairement à l'écart, avec les autres chefs des gouvernements provinciaux, au cours d'une nuit qui a été qualifié de Nuit des Longs Couteaux. Ce procédé inqualifiable est durement ressenti au Québec qui votait jusqu'à présent pour le Parti libéral aux élections fédérales. Trudeau réduit les prérogatives du Québec en matière de langue et d'éducation. En mettant le Québec au rang d'une province comme les autres, il biffe 117 ans d'histoire et renonce au concept des deux peuples fondateurs. Aux élections fédérales suivantes, la sanction tombe : les libéraux sont battus.
En 1982, la Grande-Bretagne autorise le rapatriement de la Constitution. Le Canada est indépendant et promulgue une nouvelle Constitution dont il n'existe qu'une version anglaise, puisque le Québec n'est pas d'accord, mais à laquelle il est tout de même assujetti, imbroglio juridique gros de contradictions futures.
En 1984, un militaire ouvre le feu dans les locaux de l'Assemblée nationale à Québec et tue trois personnes pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la politique.
En 1985, Robert Bourassa revient au pouvoir. Il utilise une argutie juridique pour passer outre à un jugement de la Cour suprême du Canada qui déclarait inconstitutionnelles des dispositions de la Charte de la langue française ; cette manœuvre du chef du gouvernement québécois entraîne la démission de ministres anglophones. Robert Bourassa s'affirme partisan d'une société distincte pour le Québec.
En 1986, le gouvernement libéral du Québec, énonce cinq conditions pour que la province signe la Constitution canadienne : 1°)- Reconnaissance du Québec comme société distincte. 2°)- Droit de véto sur tout changement constitutionnel. 3°)- Garanties sur la nomination des juges à la Cour suprême (1/3 doivent être québécois). 4°)- Compensations financières aux provinces qui refusent de participer aux programmes fédéraux. 5°)- Prise en charge de l'immigration sur son territoire par le Québec. Une entente paraît possible. Robert Bourassa participe à une tentative de réforme constitutionnelle avec le gouvernement fédéral et les autres provinces ; la négociation avorte. D'autres tentatives de réformes constitutionnelles auront encore lieu plus tard, sans résultat, ce qui fournit des arguments aux partisans de l'indépendance.
Ces querelles institutionnelles montrent que la revendication d’une spécificité québécoise dépasse largement le camp des souverainistes et qu’il est l’expression de la société québécoise dans son ensemble. Mais le Québec se trouve isolé car les habitants des autres provinces, quelle que soit leur origine, immigrés de date plus récente, ont adhéré aux valeurs anglo-saxonnes, du fait même de leur immigration, et ils ne comprennent pas que les Québécois, à qui ces valeurs sont imposées, puissent les rejeter.
En 1988, la Cour suprême du Canada ayant invalidé des dispositions de la Loi 101, Robert Bourassa fait adopter un texte qui restreint l'affichage bilingue ; plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour défendre la Loi 101.
En 1989 un tireur fou misogyne tue quatorze jeunes femmes à l'Ecole Polytechnique de Montréal.
Les barricades d’Oka
 En 1990, les Mohawks (Agniers) d'Oka affrontent les Blancs, la police provinciale et l'armée canadienne ; cette crise est révélatrice des frustrations ressenties par les Autochtones et de l’hostilité dont fait preuve une partie de la population blanche à leur encontre. Elle a éclatée à propos de l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière ancestral des Indiens. Elle a été marquée par l'érection de barricades, des actes de violence armée, la mort d'un policier et aussi une manifestation de Blancs qui ont brûlé un Mohawk en effigie aux cris de : « le Québec aux Québécois ». C’est le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau (né en 1930), alors dans l’opposition, qui a poussé le premier ministre libéral, Robert Bourassa, à réclamer l’intervention de l’armée canadienne.
En 1990, les Mohawks (Agniers) d'Oka affrontent les Blancs, la police provinciale et l'armée canadienne ; cette crise est révélatrice des frustrations ressenties par les Autochtones et de l’hostilité dont fait preuve une partie de la population blanche à leur encontre. Elle a éclatée à propos de l'agrandissement d'un terrain de golf sur un cimetière ancestral des Indiens. Elle a été marquée par l'érection de barricades, des actes de violence armée, la mort d'un policier et aussi une manifestation de Blancs qui ont brûlé un Mohawk en effigie aux cris de : « le Québec aux Québécois ». C’est le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau (né en 1930), alors dans l’opposition, qui a poussé le premier ministre libéral, Robert Bourassa, à réclamer l’intervention de l’armée canadienne.
En 1994, le Parti Québécois revient au pouvoir, pour le reperdre en 2003.
Depuis la révolution tranquille, les chocs pétroliers (en 1973-1974 et en 1979), la mondialisation et un accord de libre-échange, l'Alena, conclu entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, en 1992, ont modifié la donne économique et sociale. Les ressources budgétaires ont diminué; la concurrence a fait pression sur les salaires ; la précarité des travailleurs s'est accrue. Le gouvernement provincial a perdu une grande partie de sa capacité d'intervention dans le domaine économique et le Parti québécois, de gré ou de force, s'est converti au libéralisme.
Si le Canada a participé à la première guerre d’Irak, en 1991, le Québec s’est montré plus réservé que le reste du Canada. En 2003, le gouvernement du Canada refuse de participer à l’invasion de l’Irak sans un mandat des Nations Unies. Mais, là encore, l’opposition du Québec à la guerre se montre plus déterminée. A Montréal une manifestation monstre réunit plus de 150000 personnes faisant de ce défilé le plus important du monde, compte tenu de la population de la province.
Les référendums
Pendant qu'il dirigeait le Québec, conformément à ses promesses, le Parti québécois a soumis aux électeurs deux référendums d'inspiration séparatiste. Les deux ont été rejetés.
 Le premier, soutenu par René Lévesque, en 1980, proposait une nouvelle entente Québec-Canada, d'égal à égal, qualifiée de souveraineté-association ; elle a été repoussée par près de 60% des votants, mais après que Pierre Elliott Trudeau se soit engagé à réformer la Constitution. Le second, en 1995, initié par le premier ministre Jacques Parizeau, chef du Parti québécois, a été soutenu par Lucien Bouchard (né en 1938), chef de l'opposition à la Chambre des Communes d'Ottawa (Bloc québécois) et par Mario Dumont (né en 1970), chef de l'Union démocratique du Québec. Il proposait la souveraineté du Québec assortie d'un nouveau partenariat économique et politique avec le Canada. Il a été repoussé de justesse par moins de 51% des électeurs.
Le premier, soutenu par René Lévesque, en 1980, proposait une nouvelle entente Québec-Canada, d'égal à égal, qualifiée de souveraineté-association ; elle a été repoussée par près de 60% des votants, mais après que Pierre Elliott Trudeau se soit engagé à réformer la Constitution. Le second, en 1995, initié par le premier ministre Jacques Parizeau, chef du Parti québécois, a été soutenu par Lucien Bouchard (né en 1938), chef de l'opposition à la Chambre des Communes d'Ottawa (Bloc québécois) et par Mario Dumont (né en 1970), chef de l'Union démocratique du Québec. Il proposait la souveraineté du Québec assortie d'un nouveau partenariat économique et politique avec le Canada. Il a été repoussé de justesse par moins de 51% des électeurs.
En commentant ce dernier résultat, Parizeau à imputé au vote ethnique son échec de justesse. Cette formulation a soulevé la réprobation des rédactions, en raison de sa connotation raciste. Cependant, rien n'était moins vrai. En effet, les Québécois de souche se sont prononcés très majoritairement en faveur du projet, d'abord pour sortir de l'impasse où l'impossibilité de réformer la Constitution fédérale les enferme mais aussi pour cesser enfin de rendre les instances fédérales toujours responsables de leurs malheurs. C'est bien le vote anglophone qui a déçu, une fois de plus, l'attente des descendants des colons français, qu'il soit le fait des héritiers des Loyalistes ou celui des immigrants plus récents. On peut donc comprendre la rancœur des partisans du Oui et leurs réticences à l'encontre d'une immigration qui menace manifestement leur identité. De plus, selon certains observateurs, les résultats du référendum seraient entachés d'irrégularités, en raison d'un financement illégal des partisans du Non. Mais le même reproche pourrait être adressé au premier référendum dont la propagande des adversaires du projet a été largement financée par le pouvoir fédéral.
Quoi qu'il en soit, après ce second échec, Mario Dumont a demandé qu'il n'y ait pas d'autre consultation avant dix ans. Ajoutons que, en 1992, les Québécois, comme d'ailleurs les autres Canadiens, ont aussi rejeté un projet de réforme de la Constitution canadienne. L'avenir du Québec reste donc en suspens et ce n'est bon ni pour le Canada, ni pour la Belle Province, toujours en proie à des velléités rentrées d'émancipation.
Les divergences d’interprétation des textes
A la suite des résultats extrêmement serrés du dernier référendum, une loi canadienne conditionne la sécession d'une province à la clarté dans la formulation de la question référendaire et à l'expression significative d'une majorité des votants. Ce texte laisse planer un refus de discussion du gouvernement fédéral dans le cas d'une question estimée biaisée ou dans celui d'une majorité jugée insuffisante. Ces dispositions n'étant pas du goût du Québec, une loi québécoise a également vu le jour ; elle met l'accent sur le droit à l'autodétermination, reconnu à tous les peuples en droit international public, elle énonce le principe qu'une majorité simple suffi pour exprimer clairement la volonté du peuple et revendique l'intégrité territoriale de la province.
En 1996, les Québécois du Parti libéral du Canada ont proposé de remplacer le concept de société distincte par celui de Foyer principal de la langue et de la culture française en Amérique. Cette proposition, considérée comme une manœuvre, a soulevé une tempête de protestations au Québec où des Anglophones appelaient au boycott des magasins qui n'affichaient pas en anglais. La nomination d'un lieutenant-général du Québec, qui avait traité les souverainistes de fascistes, a jeté de l'huile sur le feu et le haut fonctionnaire trop bavard a dû démissionner, après la révélation de son passé antisémite !
En 1997, le gouvernement fédéral s'est opposé à rouvrir le débat constitutionnel tant que le Québec serait gouverné par les souverainistes, en dépit des dispositions de la Constitution de 1982 qui imposait un débat à cette date. Des discussions ont tout de même été amorcées afin d'adopter une version française de ladite Constitution.
Au niveau du Canada, on assiste à une provincialisation des partis (Parti réformiste dans les provinces de l'Ouest, Parti libéral en Ontario, Bloc québécois au Québec, Parti conservateur dans les Maritimes) qui met en lumière la fragilité de l'unité canadienne. Le premier ministre du Canada, Joseph-Jacques-Jean Chrétien (né en 1934), a fait planer la menace d'une partition du Québec dans le cas d'un vote favorable à l'indépendance.
En 1998, la Cour suprême du Canada a décidé, qu'en cas de réponse positive à un référendum d'indépendance, le gouvernement fédéral est tenu de négocier cette issue avec le gouvernement provincial. Fédéralistes et souverainistes interprètent différemment cet arrêt pourtant clair. La constitutionnalité d'une éventuelle sécession constitue un terrain potentiel d'affrontements entre partisans et adversaires du fédéralisme.
En 1999, l'Union sociale, signée entre le gouvernement fédéral et les provinces, sauf le Québec, a privé ce dernier d'une partie de ses prérogatives dans le domaine social. En outre, un projet de loi fédéral prévoit, qu'en cas d'accession à la souveraineté d'une province, ses frontières devraient être renégociées.
Au début du 21ème siècle, le Parti québécois semble en recul au profit du Parti libéral et de l'Action démocratique.
L’indépendance : option réaliste ou chimère ?
Une question mérite d'être posée, c'est celle de savoir si un Québec indépendant constituerait une entité viable dans le monde d'aujourd'hui. En toute objectivité, il est difficile de répondre négativement. Le Québec est trois fois grand comme la France ; sa population s'élève à 7,8 millions d'habitants (25% de la population du Canada) alors que celle de la Norvège est à peine supérieure à 4,6 millions ; ses ressources en eau douce, en énergie électrique, en bois et en minerais sont immenses. Les Québécois vivraient-ils mieux dans un pays indépendant ? C’est une autre question à laquelle chacun répond davantage avec son cœur qu’avec sa raison.
 Le Canada, ce pays démesuré semble fragile et quelque peu artificiel : sa population ne dépasse pas 31 millions d’habitants ; cette population, formée au cours du temps d'apport divers, ne paraît pas dotée d'une conscience nationale à toute épreuve ; sauf exceptions, elle se concentre sur une bande relativement étroite mais très longue, en bordure de la frontière des Etats-Unis, de sorte que les échanges s'effectuent moins dans le sens est-ouest, à l'intérieur du pays, que dans le sens nord-sud, chaque province commerçant d'abord avec l'Etat voisin des Etats-Unis ; Québec est à peine plus éloigné de Paris que de Vancouver !
Le Canada, ce pays démesuré semble fragile et quelque peu artificiel : sa population ne dépasse pas 31 millions d’habitants ; cette population, formée au cours du temps d'apport divers, ne paraît pas dotée d'une conscience nationale à toute épreuve ; sauf exceptions, elle se concentre sur une bande relativement étroite mais très longue, en bordure de la frontière des Etats-Unis, de sorte que les échanges s'effectuent moins dans le sens est-ouest, à l'intérieur du pays, que dans le sens nord-sud, chaque province commerçant d'abord avec l'Etat voisin des Etats-Unis ; Québec est à peine plus éloigné de Paris que de Vancouver !
Depuis la révolution tranquille, les mentalités ont évolué et il faut prendre cela en considération. Le monde des affaires était autrefois aux mains des Anglo-saxons ; c'est de moins en moins vrai. Les Francophones étaient cultivateurs, petits commerçants, employés de bureau, ouvriers ou, pour les plus instruits, membres du clergé et des professions libérales (médecins, avocats...). Les choses ont changé ; des étudiants francophones se sont orientés vers les disciplines scientifiques et administratives. De grandes entreprises québécoises ont percé jusqu'à devenir des multinationales, comme Bombardier. Les Ontariens et autres Anglophones peuvent difficilement considérer encore les Québécois comme des êtres inférieurs. Parallèlement les Québécois sont devenus plus sûrs d'eux. L'existence de la francophonie leur donne des raisons de croire en la pérennité d'une langue qu'ils ont su défendre et enrichir à leur manière avec beaucoup d'opiniâtreté. Cette situation nouvelle n'offre-t-elle pas des possibilités de rapprochement entre les deux peuples fondateurs du Canada ? L'avenir seul détient la réponse.
La difficile intégration de la jeunesse
En dehors du différend qui continue d'opposer fédéralistes et souverainistes, le Québec se trouve aujourd'hui confronté, comme la France, aux problèmes résultant d'une intégration difficile de sa jeunesse. C'est ainsi, qu'en 2008, à la suite de la mort d'un jeune habitant d'un quartier sensible du nord de Montréal, sous les balles de la police, des émeutes ont éclaté. Depuis l'éviction des motards, liés au trafic de drogue, des bandes rivales, qui ont pris leur place, tiennent le haut du pavé et s'en prennent aux forces de l'ordre.
Enfin, on ne saurait clore l'histoire du Québec sans rappeler l'existence des populations qui vivaient sur cette terre avant l'arrivée des Blancs. Certains Autochtones se sont métissés, d'autres se sont intégrés, tant bien que mal, à une société qui ne leur convient guère, d'autres vivent plus ou moins de la charité publique, dans des réserves. Les querelles qui divisent les Européens ne les concernent que de loin. Est-ce à dire qu'ils sont définitivement résignés à leur sort ? La crise d'Oka prouve le contraire. De temps à autre des incidents surviennent.
Tout récemment, en février 2010, le conseil de bande de la réserve de Kahnawake a décidé d'expulser toutes les personnes qui ne sont pas originaires de la tribu, même celles qui y ont un conjoint, et il a interdit aux étrangers de s'installer dans les limites de la réserve. Kahnawake ou Caughnawaga est un village mohawk (agnier). Une sainte chrétienne, Catherine Tekakwitha (le Lys des Agniers), qui aurait accompli des guérisons miraculeuses, est originaire de cette réserve, située au bord du Saint-Laurent, près de Montréal.
A propos de l'auteur
Poète, Passionné d'histoire et grand voyageur, Jean Dif a rédigé des ouvrages historiques et des récits de voyage.
Bibliographie
- Histoire de l'Amérique française de Gilles Havard. Champs Histoire, 2008.
- L'histoire de Québec : Capitale de la Nouvelle-France 1608-1760 de Raymonde Litalien. Belles lettres 2008.
- Histoire Populaire du Quebec T 01 des Origines a 1791 deJacques Lacoursière. 2005.
Pour aller plus loin
- Ressources du ministère de la culture sur l'histoire de la Nouvelle France.

